Жюль Валлес. L’Enfant (Ребёнок)
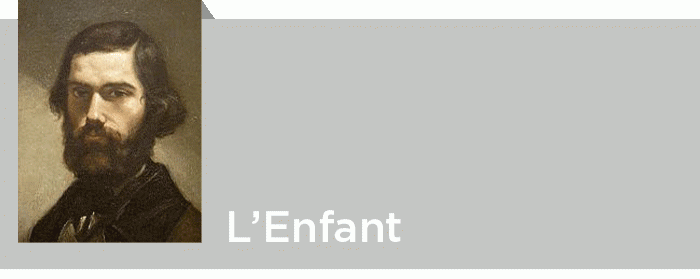
(Отрывок)
I
MA MÈRE
Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout petit : je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisotté ; j’ai été beaucoup fouetté.
Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard que quatre heures.
Mademoiselle Balandreau m’y met du suif.
C’est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-dessous de nous. D’abord elle était contente : comme elle n’a pas d’horloge, ça lui donnait l’heure. « Vlin ! Vlan ! zon ! zon ! – voilà le petit Chose qu’on fouette ; il est temps de faire mon café au lait. »
Mais un jour que j’avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l’air entre deux portes, elle m’a vu ; mon derrière lui a fait pitié.
Elle voulait d’abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour ; mais elle a pensé que ce n’était pas le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose.
Lorsqu’elle entend ma mère me dire : « Jacques, je vais te fouetter !
— Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous.
— Oh ! chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! »
Mademoiselle Balandreau m’emmène ; mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains ; moi, je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante.
« À votre service, » répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette.
Mon premier souvenir date donc d’une fessée. Mon second est plein d’étonnement et de larmes.
C’est au coin d’un feu de fagots, sous le manteau d’une vieille cheminée ; ma mère tricote dans un coin ; une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rongées, quelques assiettes de faïence bleue avec des coqs à crête rouge, et à queue bleue.
Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin ; les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de rubans. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées ; ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui fait le fer… Le chariot va être fini ; j’attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s’est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m’avance vers lui ; un coup violent m’arrête ; c’est ma mère qui me l’a donné, l’écume aux lèvres, les poings crispés.
«C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! »
Et elle me chasse sur l’escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte.
Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père : je vois, avec ma terreur d’enfant, sa main qui pend toute hachée ; c’est moi qui en suis cause ! Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me battra après si l’on veut. Je crie, on ne me répond pas. J’entends qu’on remue des carafes, qu’on ouvre un tiroir ; on met des compresses.
«Ce n’est rien, vient me dire ma cousine,» en pliant une bande de linge tachée de rouge.
Je sanglote, j’étouffe : ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j’ai peur tous les soirs.
Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide.
Ce n’est pas ma faute, pourtant !
Est-ce que j’ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n’aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu’il n’eût point mal ?
Oui — et je m’égratigne les mains pour avoir mal aussi.
C’est que maman aime tant mon père ! Voilà pourquoi elle s’est emportée.
On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu’il faut obéir à ses père et mère : Ma mère a bien fait de me battre.
La maison que nous habitons est dans une rue sale, pénible à gravir, du haut de laquelle on embrasse tout le pays, mais où les voitures ne passent pas. Il n’y a que les charrettes de bois qui y arrivent, traînées par des bœufs qu’on pique avec un aiguillon. Le front bas, le cou tendu, le pied glissant ; leur langue pend et leur peau fume. Je m’arrête toujours à les voir, quand ils portent des fagots et de la farine chez le boulanger qui est à mi-côte ; je regarde en même temps les mitrons tout blancs et le grand four tout rouge, — on enfourne avec de grandes pelles, et ça sent la croûte et la braise !
La prison est au bout de la rue, et les gendarmes conduisent souvent des prisonniers qui ont les menottes, et qui marchent sans regarder ni à droite ni à gauche, l’œil fixe, l’air malade.
Des femmes leur donnent des sous qu’ils serrent dans leurs mains en inclinant la tête pour remercier.
Ils n’ont pas du tout l’air méchant.
Un jour on en a emmené un sur une civière, avec un drap blanc qui le couvrait tout entier ; il s’était mis le poignet sous une scie, après avoir volé ; il avait coulé tant de sang qu’on croyait qu’il allait mourir.
Le geôlier, en sa qualité de voisin, est un ami de la maison ; il vient de temps en temps manger la soupe chez les gens d’en bas, et nous sommes camarades, son fils et moi. Il m’emmène quelquefois à la prison, parce que c’est plus gai ; c’est plein d’arbres ; on joue, on rit, et il y en a un, tout vieux, qui vient du bagne et qui fait des cathédrales avec des bouchons et des coquilles de noix.
À la maison l’on ne rit jamais, ma mère bougonne toujours. — Oh ! comme je m’amuse davantage avec ce vieux-là et le grand qu’on appelle le braconnier, qui a tué le gendarme à la foire du Vivarais !
Puis, ils reçoivent des bouquets qu’ils embrassent et cachent sur leur poitrine. J’ai vu, en passant au parloir, que c’étaient des femmes qui les leur donnaient.
D’autres ont des oranges et des gâteaux que leurs mères leur portent, comme s’ils étaient encore tout petits. Moi je suis tout petit, et je n’ai jamais ni gâteaux, ni oranges.
Je ne me rappelle pas avoir vu une fleur à la maison. Maman dit que ça gêne, et qu’au bout de deux jours ça sent mauvais. Je m’étais piqué à une rose l’autre soir, elle m’a crié : « Ça t’apprendra ! »
J’ai toujours envie de rire quand on dit la prière ! J’ai beau me retenir, je prie Dieu avant de me mettre à genoux, je lui jure bien que ce n’est pas de lui que je ris, mais dès que je suis à genoux, c’est plus fort que moi. Mon oncle a des verrues qui le démangent, et il les gratte, puis il les mord ; j’éclate. — Ma mère ne s’en aperçoit pas toujours, heureusement, mais Dieu, qui voit tout, qu’est-ce qu’il peut penser ?
Je n’ai pas ri pourtant, l’autre jour ! On avait dîné à la maison avec ma tante de Vourzac et mes oncles de Farreyrol ; on était en train de manger la tourte, quand tout à coup il a fait noir. On avait eu chaud tout le temps, on étouffait, et l’on avait ôté ses habits. Tout d'un coup le tonnerre a grondé. La pluie est tombée à torrents, de grosses gouttes faisaient floc dans la poussière. Il y avait une fraîcheur de cave, et aussi une odeur de poudre ; dans la rue, le ruisseau bouillait comme une lessive, puis les vitres se sont mises à grincer : il tombait de la grêle.
Mes oncles et mes tantes se sont regardés, et l’un d’eux s’est levé ; il a ôté son chapeau et s’est mis à dire une prière. Tous se tenaient debout et découverts, avec leurs fronts jeunes ou vieux pleins de tristesse. Ils priaient Dieu de n’être pas trop cruel pour leur champ, et de ne pas tuer avec son plomb blanc leurs moissons en fleur.
Un grêlon a passé par une fenêtre, au moment où l’on disait Amen, et a sauté dans un verre.
Nous venons de la campagne :
Mon père est fils d’un paysan qui a eu de l’orgueil et a voulu que son fils étudiât pour être prêtre. On a mis ce fils chez un oncle curé pour apprendre le latin, puis on l’a envoyé au séminaire.
Mon père — celui qui devait être mon père — n’y est pas resté, a voulu être bachelier, arriver aux honneurs, et s’est installé dans une petite chambre au fond d’une rue noire, d’où il sort, le jour, pour donner quelques leçons à dix sous l’heure, et où il rentre, le soir, pour faire la cour à une paysanne qui sera ma mère, et qui accomplit pour le moment ses devoirs de nièce dévouée près d’une tante malade.
On se brouille pour cela avec l’oncle curé, on dit adieu à l’église ; on s’aime, on « s’accorde, » on s’épouse ! On est aussi au plus mal avec les père et mère, à qui l’on a fait des sommations pour arriver à ce mariage de la débine et de la misère.
Je suis le premier enfant de cette union bénie. Je viens au monde dans un lit de vieux bois qui a des punaises de village et des puces de séminaire.
La maison appartient à une dame de cinquante ans qui n’a que deux dents, l’une marron et l’autre bleue, et qui rit toujours ; elle est bonne et tout le monde l’aime. Son mari s’est noyé en faisant le vin dans une cuve ; ce qui me fait beaucoup rêver et me donne grand’peur des cuves, mais grand amour du vin. Il faut que ce soit bien bon pour que M. Garnier — c’est son nom — en ait pris jusqu’à mourir. Madame Garnier boit, tous les dimanches, de ce vin qui sent l’homme qu’elle a aimé : les souliers du mort sont aussi sur une planche, comme deux chopines vides.
On se grise pas mal dans la maison où je demeure.
Un abbé qui reste sur notre carré ne sort jamais de table sans avoir les yeux hors de la tête, les joues luisantes, l’oreille en feu. Sa bouche laisse passer un souffle qui sent le fût, et son nez a l’air d’une tomate écorchée. Son bréviaire embaume la matelotte.
Il a une bonne, mademoiselle Henriette, qu’il regarde de côté, quand il a bu. On parle quelquefois d’elle et de lui dans les coins.
Au second, M. Grélin. Il est lieutenant des pompiers, et, le jour de la Fête-Dieu, il commande sur la place. M. Grélin est architecte, mais on dit qu’il n’y entend rien, que « c’est lui qui est cause que le Breuil est toujours plein d’eau, qu’il a coûté 50,000 fr. à la ville, et que, sans sa femme… » On dit je ne sais quoi de sa femme. Elle est gentille, avec de grands yeux noirs, de petites dents blanches, un peu de moustache sur la lèvre ; elle fait toujours bouffer son jupon et sonner ses talons quand elle marche.
Elle a l’accent du Midi, et nous nous amusons à l’imiter quelquefois.
On dit qu’elle a des « amants ». Je ne sais pas ce que c’est, mais je sais bien qu’elle est bonne pour moi, qu’elle me donne, en passant, des tapes sur les joues, et que j’aime à ce qu’elle m’embrasse, parce qu’elle sent bon. Les gens de la maison ont l’air de l’éviter un peu, mais sans le lui montrer.
« Vous dites donc qu’elle est bien avec l’adjoint ?
— Oui, oui, au mieux !
— Ah ! ah ! et ce pauvre Grélin ? »
J’entends cela de temps en temps, et ma mère ajoute des mots que je ne comprends pas.
« Nous autres, les honnêtes femmes, nous mourons de faim. Celles-là, on leur fourre des places pour leurs maris, des robes pour leurs fêtes ! »
Est-ce que madame Grélin n’est pas honnête ? Que fait-elle ? Qu’y a-t-il ? pauvre Grélin !
Mais Grélin a l’air content comme tout. Ils sont toujours à donner des caresses et des joujoux à leurs enfants ; on ne me donne que des gifles, on ne me parle que de l’enfer, on me dit toujours que je crie trop.
Je serais bien plus heureux si j’étais le fils à Grélin : mais voilà ! L’adjoint viendrait chez nous quand ma mère serait seule… Ça me serait bien égal, à moi.
Madame Toullier reste au troisième : voilà une femme honnête !
Madame Toullier vient à la maison avec son ouvrage, et ma mère et elle causent des gens d’en bas, des gens de dessus, et aussi des gens de Raphaël et d’Espailly. Madame Toullier prise, a des poils plein les oreilles, des pieds avec des oignons ; elle est plus honnête que madame Grélin. Elle est plus bête et plus laide aussi.
Quels souvenirs ai-je encore de ma vie de petit enfant ? Je me rappelle que devant la fenêtre les oiseaux viennent l’hiver picorer dans la neige ; que, l’été, je salis mes culottes dans une cour qui sent mauvais ; qu’au fond de la cave, un des locataires engraisse des dindes. On me laisse pétrir des boulettes de son mouillé, avec lesquelles on les bourre, et elles étouffent. Ma grande joie est de les voir suffoquer, devenir bleues. Il paraît que j’aime le bleu !
Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me calotter. C’est pour mon bien ; aussi, plus elle m’arrache de cheveux, plus elle me donne de taloches, et plus je suis persuadé qu’elle est une bonne mère et que je suis un enfant ingrat.
Oui ingrat ! car il m’est arrivé quelquefois, le soir, en grattant mes bosses, de ne pas me mettre à la bénir, et c’est à la fin de mes prières, tout à fait, que je demande à Dieu de lui garder la santé pour veiller sur moi et me continuer ses bons soins.
Je suis grand, je vais à l’école.
Oh ! la belle petite école ! Oh ! la belle rue ! et si vivante, les jours de foire !
Les chevaux qui hennissent ; les cochons qui se traînent en grognant, une corde à la patte ; les poulets qui s’égosillent dans les cages ; les paysannes en tablier vert, avec des jupons écarlates ; les fromages bleus, les tomes fraîches, les paniers de fruits ; les radis roses, les choux verts !…
Il y avait une auberge tout près de l’école, et l’on y déchargeait souvent du foin.
Le foin, où l’on s’enfouissait jusqu’aux yeux, d’où l’on sortait hérissé et suant, avec des brins qui vous étaient restés dans le cou, le dos, les jambes, et vous piquaient comme des épingles !…
On perdait ses livres dans la meule, son petit panier, son ceinturon, une galoche… Toutes les joies d’une fête, toutes les émotions d’un danger… Quelles minutes !
Quand il passe une voiture de foin, j’ôte mon chapeau et je la suis.
II
LA FAMILLE
Deux tantes du côté de ma mère, la tante Rosalie et la tatan Mariou. On appelle cette dernière tatan ; je ne sais pourquoi, parce qu’elle est plus caressante peut-être. Je vois toujours son grand rire blanc et doux dans son visage brun : elle est maigre et assez gracieuse, elle est femme.
Ma tante Rosalie, son aînée, est énorme, un peu voûtée ; elle a l’air d’un chantre ; elle ressemble au père Jauchard, le boulanger qui entonne les vêpres le dimanche et qui commence les cantiques quand on fait le Chemin de la croix. Elle est l’homme dans son ménage ; son mari, mon oncle Jean ne compte pas : il se contente de gratter une petite verrue qui joue le grain de beauté dans son visage fripé, tiré, ridé. — J’ai remarqué, depuis, que beaucoup de paysans ont de ces figures-là, rusées, vieillottes, pointues ; ils ont du sang de théâtre ou de cour qui s’est égaré un soir de fête ou de comédie dans la grange ou l’auberge, et ils sentent le cabotin, le ci-devant, le vieux noble, à travers les odeurs de l’étable à cochons et du fumier : ratatinés par leur origine, ils restent gringalets sous les grands soleils.
Le mari de la tatan Mariou, lui, est bien un bouvier ! Un beau laboureur blond, cinq pieds sept pouces, pas de barbe, mais des poils qui luisent sur son cou, un cou rond, gras, doré ; il a la peau couleur de paille, avec des yeux comme des bleuets et des lèvres comme des coquelicots ; il a toujours la chemise entr’ouverte, un gilet rayé jaune, et son grand chapeau à chenille tricolore ne le quitte jamais. J’ai vu comme cela des dieux des champs dans des paysages de peintres.
Deux tantes du côté de mon père.
Ma tante Mélie est muette, — avec cela bavarde, bavarde !
Ses yeux, son front, ses lèvres, ses mains, ses pieds, ses nerfs, ses muscles, sa chair, sa peau, tout chez elle remue, jase, interroge, répond ; elle vous harcèle de questions, elle demande des répliques ; ses prunelles se dilatent, s’éteignent ; ses joues se gonflent, se rentrent ; son nez saute ! elle vous touche ici, là, lentement, brusquement, pensivement, follement ; il n’y a pas moyen de finir la conversation. Il faut y être, avoir un signe pour chaque signe, un geste pour chaque geste, des réparties, du trait, regarder tantôt dans le ciel, tantôt à la cave, attraper sa pensée comme on peut, par la tête ou par la queue, en un mot, se donner tout entier, tandis qu’avec les commères qui ont une langue, on ne fait que prêter l’oreille : rien n’est bavard comme un sourd et muet.
Pauvre fille ! elle n’a pas trouvé à se marier. C’était certain, et elle vit avec peine du produit de son travail manuel ; non qu’elle manque de rien, à vrai dire, mais elle est coquette, la tante Amélie !
Il faut entendre son petit grognement, voir son geste, suivre ses yeux, quand elle essaye une coiffe ou un fichu ; elle a du goût : elle sait planter une rose au coin de son oreille morte, et trouver la couleur du ruban qui ira le mieux à son corsage, près de son cœur qui veut parler…
Grand’tante Agnès.
On l’appelle la « béate ».
Il y a tout un monde de vieilles filles qu’on appelle de ce nom-là.
« M’man, qu’est-ce que ça veut dire, une béate ? »
Ma mère cherche une définition et n’en trouve pas ; elle parle de consécration à la Vierge, de vœux d’innocence.
« L’innocence. Ma grand’tante Agnès représente l’innocence ? C’est fait comme cela, l’innocence ! »
Elle a bien soixante-dix ans, et elle doit avoir les cheveux blancs ; je n’en sais rien, personne n’en sait rien, car elle a toujours un serre-tête noir qui lui colle comme du taffetas sur le crâne ; elle a, par exemple, la barbe grise, un bouquet de poils ici, une petite mèche qui frisotte par là, et de tous côtés des poireaux comme des groseilles, qui ont l’air de bouillir sur sa figure.
Pour mieux dire, sa tête ressemble à une pomme de terre brûlée par le haut, à cause du serre-tête noir, et par le bas, à une pomme de terre abandonnée ; j’en ai trouvé une gonflée, violette, l’autre matin, sous le fourneau, qui ressemblait à grand’tante Agnès comme deux gouttes d’eau.
«Vœux d’innocence.»
Ma mère fait si bien, s’explique si mal, que je commence à croire que c’est malpropre d’être béate, et qu’il leur manque quelque chose, ou qu’elles ont quelque chose de trop.
Béate ?
Elles sont quatre « béates » qui demeurent ensemble — pas toutes avec des poireaux couleur de feu sur une peau couleur de cendre, comme grand’tante Agnès, qui est coquette, mais toutes avec un brin de moustache ou un bout de favoris, une noix de côtelette, et l’inévitable serre-tête, l’emplâtre noir !
On m’y envoie de temps en temps.
C’est au fond d’une rue déserte, où l’herbe pousse.
Grand’tante Agnès est ma marraine, et elle adore son filleul.
Elle veut me faire son héritier, me laisser ce qu’elle a, — pas son serre-tête, j’espère.
Il paraît qu’elle garde quelques vieux sous dans un vieux bas, et quand on parle d’une voisine chez qui l’on a trouvé un sac d’écus dans le fond d’un pot à beurre, elle rit dans sa barbe.
Je ne m’amuse pas fort chez elle, en attendant qu’on trouve son pot à beurre !
Il fait noir dans cette grande pièce, espèce de grenier soutenu par des poutres qui ont l’air en vieux bouchon, tant elles sont piquées et moisies !
La fenêtre donne sur une cour, d’où monte une odeur de boue cuite.
Il n’y a que les rideaux de lit qui me plaisent, — ils suffisent à me distraire ; on y voit des bonshommes, des chiens, des arbres, un cochon ; ils sont peints en violet sur l’étoffe, c’est le même sujet répété cent fois. Mais je m’amuse à les regarder de tous les côtés, et je vois surtout toutes sortes de choses dans les rideaux de ma grand’tante, quand je mets ma tête entre mes jambes pour les regarder.
La chasse — c’est le sujet — me paraît de toutes les couleurs. Je crois bien ! Le sang me descend à la figure ; j’ai le cerveau comme un fond de barrique : c’est l’apoplexie ! Je suis forcé de retirer ma tête par les cheveux pour me relever, et de la replacer droit comme une bouteille en vidange.
On fait des prières à tout bout de champ : Amen ! amen ! avant la rave et après l’œuf.
Les raves sont le fond du dîner qu’on m’offre quand je vais chez la béate ; on m’en donne une crue et une cuite.
Je racle la crue, qui semble mousser sous le couteau, et a sur la langue un goût de noisette et un froid de neige.
Je mords avec moins de plaisir dans celle qui est cuite au feu de la chaufferette que la tante tient toujours entre les jambes, et qui est le meuble indispensable des béates. — Huit jambes de béates : Quatre chaufferettes — qui servent de boîte à fil en été, et dont elles tournent la braise avec leur clef en hiver.
Il y a de temps en temps un œuf.
On tire cet œuf d’un sac, comme un numéro de loterie et on le met à la coque, le malheureux ! C’est un véritable crime, un coquicide, car il y a toujours un petit poulet dedans.
Je mange ce fœtus avec reconnaissance, car on m’a dit que tout le monde n’en mange pas, que j’ai le bénéfice d’une rareté, mais sans entrain, car je n’aime pas l’avorton en mouillettes et le poulet à la petite cuiller.
En hiver, les béates travaillent à la boule : elles plantent une chandelle entre quatre globes pleins d’eau, ce qui donne une lueur blanche, courte et dure, avec des reflets d’or.
En été, elles portent leurs chaises dans la rue sur le pas de la porte, et les carreaux vont leur train.
Avec ses bandeaux verts, ses rubans roses, ses épingles à tête de perle, avec les fils qui semblent des traînées de bave d’argent sur un bouquet, avec ses airs de corsage riche, ses fuseaux bavards, le carreau est un petit monde de vie et de gaieté.
Il faut l’entendre babiller sur les genoux des dentellières, dans les rues de béates, les jours chauds, au seuil des maisons muettes. Un tapage de ruche ou de ruisseau, dès qu’elles sont seulement cinq ou six à travailler, — puis quand midi sonne, le silence !…
Les doigts s’arrêtent, les lèvres bougent, on dit la courte prière de l’Angelus. Quand celle qui la dit a fini, tous répondent mélancoliquement : Amen ! et les carreaux se remettent à bavarder…
Mon oncle Joseph, mon tonton comme je dis, est un paysan qui s’est fait ouvrier. Il a vingt-cinq ans, et il est fort comme un bœuf ; il ressemble à un joueur d’orgue ; la peau brune, de grands yeux, une bouche large, de belles dents ; la barbe très noire, un buisson de cheveux, un cou de matelot, des mains énormes toutes couvertes de verrues, — ces fameuses verrues qu’il gratte pendant la prière !
Il est compagnon du devoir, il a une grande canne avec de longs rubans, et il m’emmène quelquefois chez la Mère des menuisiers. On boit, on chante, on fait des tours de force, il me prend par la ceinture, me jette en l’air, me rattrape, et me jette encore. J’ai plaisir et peur ! puis je grimpe sur les genoux des compagnons ; je touche à leurs mètres et à leurs compas, je goûte au vin qui me fait mal, je me cogne au chef-d’œuvre, je renverse des planches, et m’éborgne à leurs grands faux-cols, je m’égratigne à leurs pendants d’oreilles. Ils ont des pendants d’oreilles.
« Jacques, est-ce que tu t’amuses mieux avec ces « messieurs de la bachellerie » qu’avec nous ?
— Oh ! mais non ! »
Il appelle « messieurs de la bachellerie », les instituteurs, professeurs, maîtres de latinage ou de dessin, qui viennent quelquefois à la maison et qui parlent du collège, tout le temps ; ce jour-là, on m’ordonne majestueusement de rester tranquille, on me défend de mettre mes coudes sur la table, je ne dois pas remuer les jambes, et je mange le gras de ceux qui ne l’aiment pas ! Je m’ennuie beaucoup avec ces messieurs de la bachellerie, et je suis si heureux avec les menuisiers !
Je couche à côté de tonton Joseph, et il ne s’endort jamais sans m’avoir conté des histoires — il en sait tout plein, — puis il bat la retraite avec ses mains sur son ventre. Le matin, il m’apprend à donner des coups de poing, et il se fait tout petit pour me présenter sa grosse poitrine à frapper ; j’essaie aussi le coup de pied, et je tombe presque toujours.
Quand je me fais mal, je ne pleure pas, ma mère viendrait.
Il part le matin et revient le soir.
Comme j’attends après lui ! Je compte les heures quand il est sur le point de rentrer.
Il m’emporte dans ses bras après la soupe, et il m’emmène jusqu’à ce qu’on se couche, dans son petit atelier, qu’il a en bas, où il travaille à son compte, le soir, en chantant des chansons qui m’amusent, et en me jetant tous les copeaux par la figure ; c’est moi qui mouche la chandelle, et il me laisse mettre les doigts dans son vernis.
Il vient quelquefois des camarades le voir et causer avec lui, les mains dans les poches, l’épaule contre la porte. Ils me font des amitiés, et mon oncle est tout fier : « Il sait déjà toutes ses lettres. — Jacques, dis ton alphabet ! »
Un jour, l’oncle Joseph partit.
Ce fut une triste histoire !
Madame Garnier, la veuve de l’ivrogne qui s’est noyé dans sa cuve, avait une nièce qu’elle fit venir de Bordeaux, lors de la catastrophe.
Une grande brune, avec des yeux énormes, des yeux noirs, tout noirs, et qui brûlent ; elle les fait aller, comme je fais aller dans l’étude un miroir cassé, pour jeter des éclairs ; ils roulent dans les coins, remontent au ciel et vous prennent avec eux.
Il paraît que j’en tombai amoureux fou. Je dis « il paraît » car je ne me souviens que d’une scène de passion, d’épouvantable jalousie.
Et contre qui ?
Contre l’oncle Joseph lui-même, qui avait fait la cour à mademoiselle Célina Garnier, s’y était pris, je ne sais comment, mais avait fini par la demander en mariage et l’épouser.
L’aimait-elle ?
Je ne puis aujourd’hui répondre à cette question ; aujourd’hui que la raison est revenue, que le temps a versé sa neige sur ces émotions profondes. Mais alors, — au moment où mademoiselle Célina se maria j’étais aveuglé par la passion.
Elle allait être la femme d’un autre ! Elle me refusait, moi si pur. Je ne savais pas encore la différence qu’il y avait entre une dame et un monsieur, et je croyais que les enfants naissaient sous les choux.
Quand j’étais dans un potager, il m’arrivait de regarder ; je me promenais dans les légumes, avec l’idée que moi aussi je pouvais être père…
Mais tout de même, je tressaillais quand ma tante me tapotait les joues et me parlait en bordelais. Quand elle me regardait d’une certaine façon, le cœur me tournait, comme le jour où, sur le Breuil, j’étais monté dans une balançoire de foire.
J’étais déjà grand : dix ans. C’est ce que je lui disais :
«N’épouse pas mon oncle Joseph ! Dans quelque temps, je serai un homme : attends-moi, jure-moi que tu m’attendras ! C’est pour de rire, n’est-ce pas, la noce d’aujourd’hui ? »
Ce n’était pas pour de rire, du tout ; ils étaient mariés bel et bien, et ils s’en allèrent tous les deux.
Je les vis disparaître.
Ma jalousie veillait. J’entendis tourner la clef.
Elle me tordit le cœur, cette clef ! J’écoutai, je fis le guet. Rien ! rien ! Je sentis que j’étais perdu. Je rentrai dans la salle du festin, et je bus pour oublier.
Je n’osai plus regarder l’oncle Joseph en face depuis ce temps-là. Cependant quand il vint nous voir la veille de son départ pour Bordeaux, il ne fit aucune allusion à notre rivalité, et me dit adieu avec la tendresse de l’oncle, et non la rancune du mari !
Il y a aussi ma cousine Apollonie ; on l’appelle la Polonie.
C’est comme ça qu’ils ont baptisé leur fille, ces paysans !
Chère cousine ! grande et lente, avec des yeux bleu de pervenche, de longs cheveux châtains, des épaules de neige ; un cou frais, que coupe de sa noirceur luisante un velours tenant une croix d’or ; le sourire tendre et la voix traînante, devenant rose dès qu’elle rit, rouge dès qu’on la regarde. Je la dévore des yeux quand elle s’habille — je ne sais pas pourquoi — je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents et relever sur son épaule ronde sa chemise qui dégringole, les jours où elle couche dans notre petite chambre, pour être au marché la première, avec ses blocs de beurre fermes et blancs comme les moules de chair qu’elle a sur sa poitrine. On s’arrache le beurre de la Polonie.
Elle vient quelquefois m’agacer le cou, me menacer les côtes de ses doigts longs. Elle rit, me caresse et m’embrasse ; je la serre en me défendant, et je l’ai mordue une fois ; je ne voulais pas la mordre, mais je ne pouvais pas m’empêcher de serrer les dents, comme sa chair avait une odeur de framboise… Elle m’a crié : Petit méchant ! en me donnant une tape sur la joue, un peu fort ; j’ai cru que j’allais m’évanouir et j’ai soupiré en lui répondant ; je me sentais la poitrine serrée et l’œil plus doux.
Elle m’a quitté pour se rejeter dans son lit, en me disant qu’elle avait attrapé froid. Elle ressemble par derrière au poulain blanc que monte le petit du préfet.
J’ai pensé à elle tout le temps, en faisant mes thèmes.
Je reste quelquefois longtemps sans la voir, elle garde la maison au village, puis elle arrive tout d’un coup, un matin, comme une bouffée.
« C’est moi, dit-elle, je viens te chercher pour t’emmener chez nous ! Si tu veux venir ! »
Elle m’embrasse ! Je frotte mon museau contre ses joues roses, et je le plonge dans son cou blanc, je le laisse traîner sur sa gorge veinée de bleu !
Toujours cette odeur de framboise.
Elle me renvoie, et je cours ramasser mes hardes et changer de chemise.
Je mets une cravate verte et je vole à ma mère de la pommade pour sentir bon, moi aussi, et pour qu’elle mette sa tête sur mes cheveux !
Mon paquet est fait, je suis graissé et cravaté : mais je me trouve tout laid en me regardant dans le miroir, et je m’ébouriffe de nouveau ! Je tasse ma cravate au fond de ma poche, et, le col ouvert, la casquette tombante, je cours avoir un baiser encore. Ça me chatouillait ; je ne lui disais pas.
Le garçon d’écurie a donné une tape sur la croupe du cheval, un cheval jaune, avec des touffes de poils près du sabot ; c’est celui de ma tatan Mariou, qu’on enfourche, quand il y a trop de beurre à porter, ou de fromages bleus à vendre. La bête va l’amble ta ta ta, ta ta ta ! toute raide ; on dirait que son cou va se casser, et sa crinière couleur de mousse roule sur ses gros yeux qui ressemblent à des cœurs de moutons.
La tante ou la cousine montent dessus comme des hommes ; les mollets de ma tante sont maigres comme des fuseaux noirs, ceux de ma cousine paraissent gras et doux dans les bas de laine blanche.
Hue donc ! Ho, ho !
C’est Jean qui tire et fait virer le cheval ; il a eu son picotin d’avoine et il hennit en retroussant ses lèvres et montrant ses dents jaunes.
Le voilà sellé.
«Passez-moi Jacquinou, » dit la Polonie, qui est parvenue à abaisser sur ses genoux sa jupe de futaine et s’est installée à pleine chair sur le cuir luisant de la selle. Elle m’aide à m’asseoir sur la croupe.
J’y suis !
Mais on s’aperçoit que j’ai oublié mes habits roulés dans un torchon, sur la table d’auberge pleine de ronds de vin cernés par les mouches.
On les apporte.
« Jean, attachez-les. Mon petit Jacquinou, passe tes bras autour de ma taille, serre-moi bien. »
Le pauvre cheval a le tricotement sec et les os durs ; mais je m’aperçois à ce moment que ce que dit la fable qu’on nous fait réciter est vrai.
Dieu fait bien ce qu’il fait !
Ma mère en me fouettant m’a durci et tanné la peau.
« Serre, je te dis ! Serre-moi plus fort ! »
Et je la serre sous son fichu peint de petites fleurs comme des hannetons d’or, je sens la tiédeur de sa peau, je presse le doux de sa chair. Il me semble que cette chair se raffermit sous mes doigts qui s’appuient, et tout à l’heure, quand elle m’a regardé en tournant la tête, les lèvres ouvertes et le cou rengorgé, le sang m’est monté au crâne, a grillé mes cheveux.
J’ai un peu desserré les bras dans la rue Saint-Jean. C’est par là que passent les bestiaux, et nous allions au pas. J’étais tout fier. Je me figurais qu’on me regardait, et je faisais celui qui sait monter : je me retournais sur la croupe en m’appuyant du plat de la main, je donnais des coups de talons dans les cuisses et je disais hue ! comme un maquignon.
Nous avons traversé le faubourg, passé le dernier bourrelier.
Nous sommes à Expailly !
Plus de maisons ! excepté dans les champs quelques-unes ; des fleurs qui grimpent contre les murs, comme des boutons de rose le long d’une robe blanche ; un coteau de vignes, et la rivière au bas — qui s’étire comme un serpent sous les arbres, bordée d’une bande de sable jaune, plus fin que de la crème, et piqué de cailloux qui flambent comme des diamants.
Au fond, des montagnes. Elles coupent de leur échine noire, verdie par le poil des sapins, le bleu du ciel où les nuages traînent en flocons de soie ; un oiseau, quelque aigle sans doute, avait donné un grand coup d’aile et il pendait dans l’air comme un boulet au bout du fil.
Je me rappellerai toujours ces bois sombres, la rivière frissonnante, l’air tiède et le grand aigle…
J’avais oublié que j’étais le cœur battant contre le dos de la Polonie. Elle-même, ma cousine, semblait ne penser à rien, et je ne me souviens avoir entendu que le pas du cheval et le beuglement d’une vache…
III
LE COLLÈGE
Le collège. — Il donnait, comme tous les collèges, comme toutes les prisons, sur une rue obscure, mais qui n’était pas loin du Martouret, le Martouret, notre grande place, où étaient la mairie, le marché aux fruits, le marché aux fleurs, le rendez-vous de tous les polissons, la gaieté de la ville. Puis le bout de cette rue était bruyant, il y avait des cabarets, « des bouchons, » comme on disait, avec un trognon d’arbre, un paquet de branches, pour servir d’enseigne. Il sortait de ces bouchons un bruit de querelles, un goût de vin qui me montait au cerveau, m’irritait les sens et me faisait plus joyeux et plus fort.
Ce goût de vin ! — la bonne odeur des caves ! — j’en ai encore le nez qui bat et la poitrine qui se gonfle.
Les buveurs faisaient tapage ; ils avaient l’air sans souci, bons vivants, avec des rubans à leur fouet et des agréments pleins leur blouse — ils criaient, topaient en jurant, pour des ventes de cochons ou de vaches.
Encore un bouchon qui saute, un rire qui éclate, et les bouteilles trinquent du ventre dans les doigts du cabaretier ! Le soleil jette de l’or dans les verres, il allume un bouton sur cette veste, il cuit un tas de mouches dans ce coin. Le cabaret crie, embaume, empeste, fume et bourdonne.
À deux minutes de là, le collège moisit, sue l’ennui et pue l’encre ; les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas, pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l’étude.
Quelle odeur de vieux !…
C’est mademoiselle Balandreau qui m’y conduit. — Ma mère est souffrante. — On me fait mon panier avant de partir, et je vais m’enfermer là-dedans jusqu’à huit heures du soir. À ce moment-là, mademoiselle Balandreau revient et me ramène. J’ai le cœur bien gros quelquefois et je lui conte mes peines en sanglotant.
Mon père fait la première étude, celle des élèves de mathématiques, de rhétorique et de philosophie. Il n’est pas aimé, on dit qu’il est chien.
Il a obtenu du proviseur la permission de me garder dans son étude, près de sa chaire, et je suis là, faisant mes devoirs à ses côtés, tandis qu’il prépare son agrégation.
Il a eu tort de me prendre avec lui. Les grands ne sont pas trop méchants pour moi ; ils me voient timide, craintif, appliqué ; ils ne me disent rien qui me fasse de la peine, mais j’entends ce qu’ils disent de mon père, comment ils l’appellent ; ils se moquent de son grand nez, de son vieux paletot, ils le rendent ridicule à mes yeux d’enfant, et je souffre sans qu’il le sache.
Il me brutalise quelquefois dans ces moments-là. « Qu’est-ce que tu as donc ? — Comme il a l’air nigaud ! »
Je viens de l’entendre insulter et j’étais en train de dévorer un gros soupir, une vilaine larme.
Il m’envoie souvent, pendant l’étude du soir, demander un livre, porter un mot à un des autres pions qui est au bout de la cour, tout là-bas… il fait noir, le vent souffle ; de temps en temps, il y a des étages à monter, un long corridor, un escalier obscur, c’est tout un voyage : on se cache dans les coins pour me faire peur. Je joue au brave, mais je ne me sens bien à l’aise que quand je suis rentré dans l’étude où l’on étouffe.
J’y reste quelquefois tout seul, quand mademoiselle Balandreau est en retard. Les élèves sont allés souper, conduits par mon père.
Comme le temps me semble long ! C’est vide, muet ; et s’il vient quelqu’un, c’est le lampiste qui n’aime pas mon père non plus, je ne sais pourquoi : un vieux qui a une loupe, une casquette de peau de bête et une veste grise comme celle des prisonniers ; il sent l’huile, marmotte toujours entre ses dents, me regarde d’un œil dur, m’ôte brutalement ma chaise de dessous moi, sans m’avertir, met le quinquet sur mes cahiers, jette à terre mon petit paletot, me pousse de côté comme un chien, et sort sans dire un mot. Je ne dis rien non plus, et ne parle pas davantage quand mon père revient. On m’a appris qu’il ne fallait pas « rapporter. » Je ne le fais point, je ne le ferai jamais dans le cours de mon existence de collégien, ce qui me vaudra bien des tortures de la part de mes maîtres.
Puis, je ne veux pas que parce qu’on m’a fait mal, il puisse arriver du mal à mon père, et je lui cache qu’on me maltraite, pour qu’il ne se dispute pas à propos de moi. Tout petit, je sens que j’ai un devoir à remplir, ma sensibilité comprend que je suis un fils de galérien, pis que cela ! de garde-chiourme ! et je supporte la brutalité du lampiste.
J’écoute, sans paraître les avoir entendues, les moqueries qui atteignent mon père ; c’est dur pour un enfant de neuf ans.
Il est arrivé que j’ai eu très faim, quelques-uns de ces soirs-là, quand on tardait trop à venir. Le réfectoire lançait des odeurs de grillé, j’entendais le cliquetis des fourchettes à travers la cour.
Comme je maudissais mademoiselle Balandreau qui n’arrivait pas !
J’ai su depuis qu’on la retenait exprès ; ma mère avait soutenu à mon père que s’il n’était pas une poule mouillée, il pourrait me fournir mon souper avec les restes du sien, ou avec le supplément qu’il demanderait au réfectoire.
« Si c’était elle, il y a longtemps que ce serait fait. Il n’avait qu’à mettre cela dans du papier. Elle lui donnerait une petite boîte, s’il voulait. »
Mon père avait toujours résisté — le pauvre homme. La peur d’être vu ! le ridicule s’il était surpris — la honte ! Ma mère tâchait de lui forcer la main de temps en temps, en me laissant affamé, dans son étude, à l’heure du souper. Il ne cédait pas, il préférait que je souffrisse un peu et il avait raison.
Je me souviens pourtant d’une fois où il s’échappa du réfectoire, pour venir me porter une petite côtelette panée qu’il tira d’un cahier de thèmes où il l’avait cachée: il avait l’air si troublé et repartit si ému ! Je vois encore la place, je me rappelle la couleur du cahier, et j’ai pardonné bien des torts plus tard à mon père, en souvenir de cette côtelette chipée pour son fils, un soir, au lycée du Puy…
Le proviseur s’appelle Hennequin, — envoyé en disgrâce dans ce trou du Puy.
Il a écrit un livre : Les Vacances d’Oscar.
On les donne en prix, et après ce que j’ai entendu dire, ce que j’ai lu à propos des gens qui étaient auteurs, je suis pris d’une vénération profonde, d’une admiration muette pour l’auteur des Vacances d’Oscar, qui daigne être proviseur dans notre petite ville, proviseur de mon père, et qui salue ma mère quand il la rencontre.
J’ai dévoré Les Vacances d’Oscar.
Je vois encore le volume cartonné de vert, d’un vert marbré qui blanchissait sous le pouce et poissait les mains, avec un dos de peau blanche, s’ouvrant mal, imprimé sur papier à chandelle. Eh bien ! il tombe de ces pages, de ce malheureux livre, dans mon souvenir, il tombe une impression de fraîcheur chaque fois que j’y songe!
Il y a une histoire de pêche que je n’ai point oubliée.
Un grand filet luit au soleil, les gouttes d’eau roulent comme des perles, les poissons remuent dans les mailles, deux pêcheurs sont dans l’eau jusqu’à la ceinture, c’est le frisson de la rivière.
Il avait su, cet Hennequin, ce proviseur dégommé, ce chantre du petit Oscar, traîner ce grand filet le long d’une page et faire passer cette rivière dans un coin de chapitre…
Le professeur de philosophie — M. Beliben — petit, fluet, une tête comme le poing, trois cheveux, et un filet de vinaigre dans la voix.
Il aimait à prouver l’existence de Dieu, mais si quelqu’un glissait un argument, même dans son sens, il indiquait qu’on le dérangeait, il lui fallait toute la table, comme pour une réussite.
Il prouvait l’existence de Dieu avec des petits morceaux de bois, des haricots.
« Nous plaçons ici un haricot, bon ! — là, une allumette. — Madame Vingtras, une allumette ? — Et maintenant que j’ai rangé, ici les vices de l’homme, là les vertus, j’arrive avec les facultés de l’âme. »
Ceux qui n’étaient pas au courant, regardaient du côté de la porte s’il entrait quelqu’un, ou du côté de sa poche, pour voir s’il allait sortir quelque chose. Les facultés de l’âme, c’était de la haute, du chenu ! Ma mère était flattée.
« Les voici ! »
On se tournait encore, malgré soi, pour saluer ces dames, mais Beliben vous reprenait par le bouton du paletot et tapait avec impatience sur la table. Il lui fallait de l’attention. Que diable ! voulait-on qu’il prouvât l’existence de Dieu, oui ou non!
« Moi, ça m’est égal, et vous ? » disait mon oncle Joseph à son voisin, qui faisait chut, et allongeait le cou pour mieux voir.
Mon oncle remettait nonchalamment ses mains dans ses poches et regardait voler les mouches.
Mais le professeur de bon Dieu tenait à avoir mon oncle pour lui et le ramenait à son sujet, l’agrippant par son amour-propre et s’accrochant à son métier.
« Chadenas, vous qui êtes menuisier, vous savez qu’avec le compas… »
Il fallait aller jusqu’au bout : à la fin le petit homme écartait sa chaise, tendait une main, montrait un coin de la table et disait : « DIEU EST LÀ. »
On regardait encore, tout le monde se pressait pour voir, tous les haricots étaient dans un coin avec les allumettes, les bouts de bouchons et quelques autres saletés, qui avaient servi à la démonstration de l’Être suprême.
Il paraît que les vertus, les vices, les facultés de l’âme venaient toutes fa-ta-le-ment aboutir à ce tas-là. Tous les haricots y sont. Donc Dieu existe. C. Q. F. D.
Произведения
Критика












