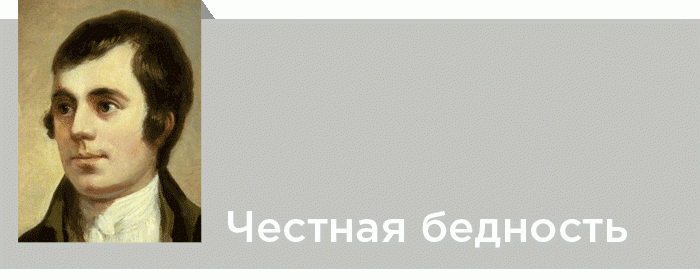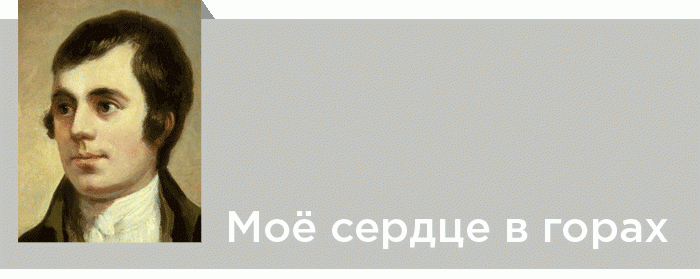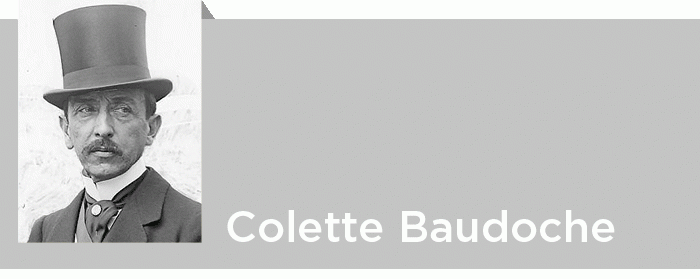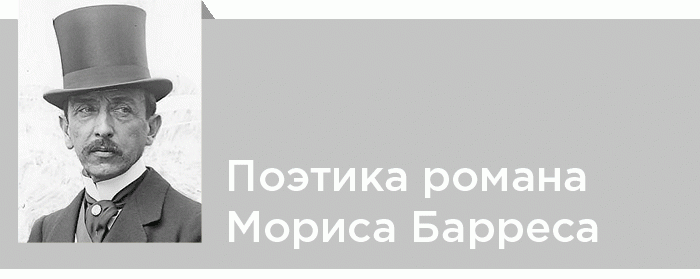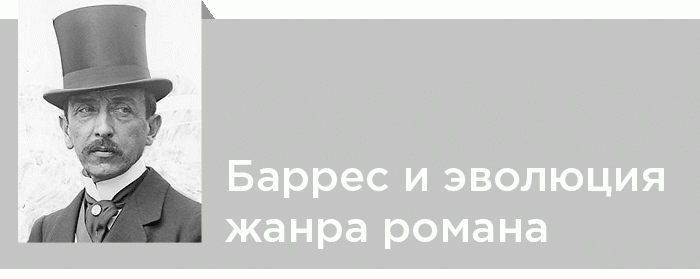Морис Баррес. Вдохновенный холм

(Отрывок)
CHAPITRE PREMIER
IL EST DES LIEUX OÙ SOUFFLE L’ESPRIT
Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. L’étroite prairie de Lourdes, entre un rocher et son gave rapide ; la plage mélancolique d’où les Saintes-Maries nous orientent vers
Tout l’être s’émeut, depuis ses
D’où vient la puissance de ces lieux ? La doivent-ils au souvenir de quelque grand fait historique, à la beauté d’un site exceptionnel, à l’émotion des foules qui du fond des âges y vinrent s’émouvoir ? Leur vertu est plus mystérieuse. Elle précéda leur gloire et saurait y survivre. Que les chênes fatidiques soient coupés, la fontaine remplie de sable et les sentiers recouverts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. La vapeur de leurs oracles s’exhale, même s’il n’est plus de prophétesse pour la respirer. Et n’en doutons pas, il est de par le monde infiniment de ces points spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont nul n’a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d’une heureuse et profonde journée, n’avons-nous pas rencontré la lisière d’un bois, un sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandaient de faire taire nos pensées et d’écouter plus profond que notre cœur ! Silence ! les dieux sont ici.
Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l’ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un sens de l’existence plus secret que celui qui nous est familier, et, sans rien nous expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de notre destinée. Ces influences longuement soutenues produiraient d’elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que, chargées d’une mission spéciale, ces terres doivent intervenir, d’une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres supérieurs et favoriser les hautes idées morales. C’est là que notre nature produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des grandes croyances. Un rationalisme indigne de son nom veut ignorer ces endroits souverains. Comme si la raison pouvait mépriser aucun fait d’expérience.
Seuls des yeux distraits ou trop faibles ne distinguent pas les feux de ces éternels buissons ardents. Pour l’âme, de tels espaces sont des puissances comme la beauté ou le génie. Elle ne peut les approcher sans les reconnaître. Il y a des lieux où souffle l’esprit.
I
De quel charme bizarre, aussitôt que je l’aperçois, ne saisit-elle pas mon esprit et mon cœur, cette montagne en demi-lune, à la fois charmante et grave ! Je songe à notre nation très positive, mais où éclatent le courage guerrier et la grandeur dans l’infortune ; je songe à nos femmes lorraines qui deviennent en vieillissant si aisément des prophétesses, et je vois les cheveux au vent de Jeanne d’Arc, de Marie Stuart et de Marie-Antoinette, ces filles royales que notre race fournit à la poésie universelle ; j’entends l’éclat de rire de Bassompierre, l’extravagance de Charles IV : c’est le point où l’imagination peut le mieux venir se poser pour comprendre le génie propre de
Ici, jadis, du temps des Celtes, la déesse Rosmertha sur la pointe de Sion faisait face au dieu Wotan, honoré sur l’autre pointe à Vaudémont. C’était deux parèdres, deux divinités jumelles. Wotan étayait Rosmertha, et l’un et l’autre protégeaient la plaine. La déesse à la figure jeune, aux cheveux courts, au sein nu, s’est évanouie ; elle fut chassée par
Aujourd’hui, de Vaudémont rien ne subsiste qu’un haut mur sous d’antiques frênes, où l’on a vu, pèlerine inconnue, passer l’impératrice Élisabeth, et dans Sion, la vierge noire, l’image antique associée au pouvoir politique du pays, a disparu sous le marteau impie d’une bande venue de Vézelise en 1793. Les grands souvenirs de la colline sont voilés ou déchus. Pourtant la plus pauvre imagination ne laisse pas de percevoir qu’autour de ce haut lieu s’organise l’histoire de
Cette image que les comtes de Vaudémont honoraient dans leur chapelle, demeure sur l’autel du pèlerinage comme un signe extrême de l’entente séculaire, et l’on croit voir, dans cette substitution de
II
En automne, la colline est bleue sous un grand ciel ardoisé, dans une atmosphère pénétrée par une douce lumière d’un jaune mirabelle. J’aime y monter par les jours dorés de septembre et me réjouir là-haut du silence, des heures unies, d’un ciel immense où glissent les nuages et d’un vent perpétuel qui nous frappe de sa masse.
Une église, un monastère, une auberge qui n’a de clients que les jours de pèlerinage, occupent l’une des cornes du croissant à l’autre extrémité, le pauvre village de Vaudémont, avec les deux aiguilles de son clocher et de sa tour, se meurt dans les débris romains et féodaux de son passé légendaire, petit point très net et prodigieusement isolé dans un grand paysage de ciel et de terre. Au creux, et pour ainsi dire au cœur de cette colline circulaire, un troisième village, Saxon, rassemble ses trente maisons aux toits brunâtres qui possèdent là tous leurs moyens de vivre : champs, vignes, vergers, chènevières et carrés de légumes. Sur la hauteur, c’est un plateau, une promenade de moins de deux heures à travers des chaumes et des petits bois, que la vue embrasse et dépasse pour jouir d’un immense horizon et de l’air le plus pur. Mais ce qui vit sur la colline ne compte guère et ne fait rien qu’approfondir la solitude et le silence. Ce qui compte et ce qui existe, où que nous menions nos pas en suivant la ligne de faîte, c’est l’horizon et ce vaste paysage de terre et de ciel.
Si vous portez au loin votre regard, vous distinguez et dénombrez les ballons des
III
Où sont les dames de Lorraine, sœurs, filles et femmes des Croisés, qui s’en venaient prier à Sion pendant que les hommes d’armes, là-bas, combattaient l’infidèle, et celles-là surtout qui, le lendemain de la bataille de Nicopolis, ignorantes encore, mais épouvantées par les rumeurs, montèrent ici intercéder pour des vivants qui étaient déjà des morts ? Où la sainte princesse Philippe de Gueldre, à qui Notre-Dame de Sion découvrit, durant le temps de son sommeil, les desseins ambitieux des ennemis de
« On n’osera pas guerroyer la mère de Dieu ! » Où sont nos chefs héréditaires, toute notre famille ducale qui, lorsqu’elle quitta pour toujours, par la défaillance de François III, le vieux duché et des sujets dont le loyalisme n’avait jamais failli, voulut une dernière fois s’agenouiller au sanctuaire de Sion ?…
Où sont-ils, Vierge souveraine ?
Mais où sont les neiges d’antan ?
Ces puissantes figures ont disparu qui combattaient pour
Et pourtant, à chaque fois qu’un Lorrain gravit la colline, des ombres l’accueillent. Naissent-elles de son cœur, des ruines seigneuriales, de la mince forêt ou des trois villages ? Elles sont faites d’espérance, l’espérance de revoir encore ce qui une fois a été vu. Sur les pentes de cette acropole, d’âge en âge ont retenti tous ces grands cris de vigueur et de confiance indéterminée : Hic, ad hoc, spes avorum… Non inultus premor… C’ n’o me po tojo… qui sont l’âme de notre nation. Ombres silencieuses, j’entends votre message ! Le secret de Sion doit être cherché dans ce regard tourné vers les nues qu’il y eut toujours sur cette colline. Elle est dévastée, dépouillée, toute pauvre. Rien n’y rend sensible l’histoire, rien n’y raconte avec clarté la succession des siècles. Qu’est-ce que la tour de Brunehaut, la chapelle du pèlerinage où si peu de parties sont vieilles, et trois, quatre
Les quatre vents de
IV
Un homme a souffert de ce silence de Sion. Un homme, un prêtre, encadré de ses deux frères, prêtres eux-mêmes, les trois frères Baillard, au siècle dernier. On ne peut pas dire que ces personnages sont venus se placer dans la série des noms dignes de mémoire sur la colline nationale, et qu’ils forment le dernier anneau de la belle chaîne interrompue qui gît sur les friches de Sion-Vaudémont ; mais je suis attiré près d’eux, parce qu’une partie de mes pensées ou de mes impressions les plus instinctives sont celles-là mêmes pour lesquelles ils se dévouèrent, et que ces barbares sont ainsi mes parents. Ce sont eux qui, au lendemain de
Si par une belle après-midi d’automne, sous notre ciel triste, je visite quelque ruine féodale, ou bien dans une église froide une
Ce que les Baillard imprimaient à la terre
Et pourtant, c’est un lourd silence autour des trois frères Baillard, un double silence, celui de l’oubli naturel et celui voulu par l’Église. Vous pouvez passer et repasser à Flavigny, à Mattaincourt, à Sainte-Odile et à Sion, aucun indice ne vous dira ce qu’ils ont jeté de jeunesse, d’argent, de temps, d’activité et d’amour dans les fondations de ces bâtiments. Pourquoi leur nom n’est-il inscrit nulle part sur les
J’ai souvent interrogé sur les Baillard mon regretté ami, le chanoine Pierfitte, le savant curé de Portieux. À chaque fois il se taisait, détournait la conversation. Un jour, il s’en est expliqué en deux mots : « C’est encore trop tôt pour parler des Baillard. » Trouvait-il que l’autorité s’était montrée bien dure envers ces vieux Lorrains ? Rien ne m’assure que telle fut son opinion. Je crois plutôt qu’il distinguait le rôle du Diable dans cette affaire, et qu’il redoutait de remuer des souvenirs d’où pouvaient encore émaner des maléfices. La réserve de Monsieur Pierfitte ne pouvait, faut-il l’avouer, qu’exciter ma curiosité. Comment accepter de ne rien savoir d’un mystique, métamorphosé par sa passion même et qui entre dans le cercle du noir enchanteur ?
Pendant longtemps, ces trois prêtres furent dans mon esprit une sorte de brouillard mystérieux. Ils flottaient devant moi aux parties les plus solitaires et les plus solennelles de la côte de Sion, surtout les jours où la brume l’enveloppe et l’isole. Ils m’attiraient. Pendant des années, dix, vingt ans peut-être, je me suis renseigné sur Quirin, sur le grand François, sur le fameux Léopold. Je m’étonnais que ce dernier ne fût mort qu’en 1883, et je cherchais à me souvenir si, enfant, je ne l’avais pas rencontré.
Bien que cette histoire se fût concentrée sur quelques lieues de terrain, mon enquête n’était pas aisée. La tradition orale s’efface vite, ne dépasse jamais le siècle, et dès maintenant c’est comme une mare d’indifférence qui s’est épaissie sur la mémoire des Baillard, aux lieux mêmes où ils ont le plus agi. À Flavigny, à Mattaincourt, à Sainte-Odile, il n’y a que leurs bâtiments qui émergent de l’oubli et autour de ces grandes murailles, dont le pied trempe dans la plus noire ingratitude, personne pour me renseigner. Sur la montagne de Sion, la figure des Baillard demeure plus vivante. L’ébranlement y fut si fort qu’il a laissé une longue vibration dans les mémoires paysannes. Mais déjà le chercheur, à la place des faits exacts qu’il sollicite, ne trouve plus qu’une matière légendaire. On lui propose trois frères Baillard aux figures simples, contrastées et fortement dessinées, qui rappellent la manière mi-épique, mi-gouailleuse des Quatre fils Aymon. Ils ne sont pas seuls. Autour d’eux on voit s’empresser des femmes — sont–ce des paysannes ? sont-ce des religieuses ? — qui les aident et que la légende ne respecte pas plus que des nonnes du moyen âge. Et je me dis parfois que si l’imprimé n’aboutissait pas, de nos jours, à tuer toute production spontanée du génie populaire, l’aventure de ces trois prêtres viendrait tout naturellement se placer dans la série de la geste
Ma longue curiosité n’avait guère de chance d’être jamais satisfaite. Elle s’endormait presque. Le hasard d’un coup d’œil jeté sur le catalogue de la bibliothèque de
Voici ce livre, tel qu’il est sorti d’une infinie méditation au grand air, en toute liberté, d’une complète soumission aux influences de la colline sainte, et puis d’une étude méthodique des documents les plus rebutants. Voici les trois frères Baillard. J’ai relevé leur histoire avant que personne les eût défigurés et quand la platitude et l’enthousiasme s’y mêlaient inextricablement. Je puis dire que je suis arrivé auprès de ces phénomènes religieux et sur le bord de cet étang aux rives indéterminées, quand personne n’en troublait encore le silence. J’ai surpris la poésie au moment où elle s’élève comme une brume des terres solides du réel.
CHAPITRE II
GRANDEUR ET DÉCADENCE D’UN SAINT ROYAUME LORRAIN AU DIX-NEUVIEME SIÈCLE
Je me souviens du jour d’octobre, couvert et grave, où je suis allé à Borville visiter le pays des Baillard. Dans un canton rural de la vieille Lorraine, entre Épinal et Lunéville, c’est un village immobile, abrité contre une faible côte, non loin de la forêt de Charmes, un village très pieux, à juger d’après les vierges qui protègent la porte de la plupart des maisons, et rempli d’élégants motifs de style renaissance (datés du dix-septième siècle, ce qui prouve que les modes arrivaient lentement à Borville). J’ai vainement cherché, la tombe du père des Baillard, cette tombe où ses fils avaient gravé ces quatre mots révélateurs de leur orgueil ; « Ci-git Léopold Baillard, père de trois prêtres. » Le cimetière est petit autour de l’église, et, sous l’immense sycomore qui les ombrage, les morts, depuis 1836, ont dû faire place à de nouveaux venus. On n’a pu que m’indiquer sous la grande croix la place qu’occupait la
Les trois frères Baillard sortirent d’une lignée profondément religieuse, à l’heure dramatique où la persécution exaltait cette religion héréditaire. Dans tous nos villages, on voit de ces familles dévouées au curé de la paroisse. Ce sont elles qui fournissent le sacristain et les enfants de chœur ; les femmes y veillent à l’entretien des linges sacrés et des ornements sacerdotaux ; elles décorent l’église aux approches des grandes fêtes, et si la servante du curé vient à manquer, elles font l’intérim. Les plus zélées de ces familles gardent une vague tradition de la dîme : les premiers fruits du jardin sont portés au presbytère, et chaque génération donne un de ses fils à l’Église.
A la fin du dix-huitième siècle, les Baillard de Borville étaient une de ces familles quasi sacerdotales. Lors de
Les heureux époux recueillirent avec un religieux respect ces souhaits de bienvenue, et à mesure que Léopold grandissait au milieu de ses frères et sœurs, ils aimaient les lui rappeler pour l’encourager dans le chemin de la vertu. Le grand-père Baillard, plus encore, éveillait dans ces enfants une imagination héroïque. Souvent il les groupait autour de son établi de cordonnier, et leur racontait intarissablement les histoires locales et domestiques dont il avait été le héros :
— Voyez, petits, disait-il, c’est dans cette chambre où je vous parle qu’était l’église en ce temps-là. Quand le Tiercelin de Sion, revenant de quelque tournée dangereuse, rentrait chez nous à la nuit tombante, vite votre grand’mère disait à votre père : « Va, cours avertir les bons ; la messe aura lieu sur le coup de minuit. » Les bons arrivaient l’un après l’autre en se glissant le long des maisons. Au coup de minuit, ils tombaient à genoux pour l’élévation, à la place même où vous êtes assis. Une nuit, les sans-culottes entrèrent ici par surprise et en armes. Votre grand-père était absent, et votre grand’mère avec vos parents n’eut que le temps de pousser le prêtre dans la cachette, au bout du jardin, et de courir dans les champs. Mais par malheur elle avait mal compté ses petites-filles et oublié votre tante Françoise, qui demeura seule pour tenir tête à ces bandits. L’un d’eux lui appliqua le canon de son fusil sur la gorge. « Tu n’oserais pas ! » cria-t-elle, et le brigand se trouva désarmé. Mais ils brisèrent tout, burent, mangèrent, pillèrent et sortirent enfin en hurlant : « Vive
Le bonhomme leur racontait encore l’installation de l’Arbre de
— On prit un de vos parents malgré ses résistances. Les sans-culottes lui passèrent au côté l’écharpe tricolore et lui appliquèrent avec violence la tête contre le peuplier, tellement que le sang jaillit. Ce sang de chrétien, ils l’offrirent à leur déesse Raison, et soudain, pris de délire, se formèrent en rond, hommes, femmes et enfants, chantant, criant des couplets en l’honneur de leur déesse. Puis le curé assermenté (qu’il soit maudit, l’apostat !) vint asperger le peuplier d’eau soi-disant bénite. pendant ce temps, mes petits, que faisaient vos bons parents ? Ils priaient et se tenaient la face contre terre, pour ne pas voir le loup-garou opérer ses profanations.
Des enfants conçus dans de telles émotions, formés de ce sang et bercés par des récits d’un si ferme caractère hagiographique, étaient prédestinés. Ils étaient le fruit d’une longue pensée sacerdotale, ils ne pouvaient avoir qu’un rêve, qu’une mission : Léopold Baillard entra au séminaire, ses deux frères l’y suivirent.
Léopold se distingua, au cours de ses études, par l’âpreté avec laquelle il soutenait les opinions philosophiques et théologiques qu’il avait une fois adoptées. D’ailleurs bon latiniste et grand amateur de beau langage. Moins brillant, François se faisait peut-être plus aimer. Ses condisciples s’amusaient, dans les récréations, à former le cercle autour de lui, pour l’entendre déclamer d’une voix très forte et très souple le célèbre exorde du Père Bridaine : « A la vue d’un auditoire aussi nouveau pour moi… » Quant au jeune Quirin, leur cadet, c’était une figure pointue, rapide à argumenter. Il offrait sous la soutane un singulier mélange de fantassin et d’avocat de justice de paix. Est-il besoin de dire qu’aucune objection ne se forma jamais dans l’esprit de ces jeunes clercs ? Ce qu’on leur enseignait rassemblait en corps de doctrine les sentiments profonds et les bribes d’idées sur lesquelles vivaient, depuis toujours, leurs familles. Le monde et l’histoire leur étaient clairs. Ils savaient comment l’univers a commencé et comment il finira ; ils savaient aussi que leur double existence, temporelle et éternelle, allait être assurée dans les œuvres de l’Église. D’ailleurs, pour avoir la soutane, ils n’en gardaient pas moins, de corps et d’esprit, les mœurs de leurs camarades en blouse. Tout brillants de jeunesse, de santé physique et morale, ils demeuraient les frères de ces robustes garçons de ferme que l’on voit, le dimanche, devant l’église sur la place. Ils étaient la fleur du canton, trois bonnes fleurs campagnardes, sans étrangeté, sans grand parfum ni rareté. mettons trois fleurs de pomme de terre.
Quelles vacances charmantes on passait dans la vieille maison de Borville ! Comme ils étaient contents, le père et la mère Baillard, à l’arrivée de leurs abbés ! La table se couvrait de quiches, de tourtes à la viande, de tartes de mirabelles, de fruits de toute sorte et du bon vin récolté dans la vigne paternelle, sur le coteau de Vahé. Au dessert, les abbés, à l’émerveillement de leurs plus jeunes frères et sœurs, chantaient quelques couplets sur le bonheur des vacances ou quelque cantique, car tous les trois, et surtout Léopold, étaient sensibles à la beauté des voix.
Souvent des camarades du séminaire et des prêtres du voisinage venaient prendre leur part de ces minutes heureuses. Mais le plus beau jour, ce fut quand Mgr de Forbin-Janson, en tournée de confirmation, voulut s’asseoir à la table d’une famille si recommandable. Madame Baillard avait fait toilette. « Ah ! dit Sa Grandeur agréablement, la mère Baillard a mis sa robe de soie gorge de pigeon. »
Dans cette journée, qui marque peut-être le plus haut moment de cette famille cléricale, nul des Baillard ne sentit la condescendance du grand seigneur chez l’évêque, pas plus que celui-ci ne soupçonna les charbons cachés sous la cendre et qui échauffaient l’âme de ces serviteurs obscurs. Il ne vit pas les deux faces de l’orgueil des Baillard : orgueil devant tout le pays d’être reconnus par les autorités hiérarchiques comme des soutiens de la religion, et orgueil devant ces autorités d’être la profonde
Ces sacrifices, Léopold, François, Quirin sont prêts, indifféremment, à les renouveler ou bien à en récolter le fruit. Tout ensemble paysans, prêtres et soldats, ils s’avancent pour conquérir dans les armées du ciel, comme ils eussent fait dans les armées de l’Empereur, les grades, les titres, les dotations, la gloire. Fermes dans leur foi d’ailleurs, comme ils eussent été fermes au feu.
Au sortir du séminaire, à l’âge de vingt-quatre ans, Léopold fut nommé curé de la belle et importante paroisse de Flavigny-surMoselle. Il y arriva en 1821, tout impatient de se distinguer, d’autant que son journal le faisait participer aux fièvres du grand effort catholique auquel
L’imagination de Léopold était maigre, sans génie, je veux dire incapable d’invention, mais d’une force prenante extraordinaire. Qu’on lui fournît un point de départ à son gré, il n’en démordait plus. Il se tenait sur l’idée qu’il avait une fois faite sienne avec cette application obstinée, minutieuse et si souvent bizarre que l’on voit chez les dessinateurs lorrains. Quand il fut parvenu, à force de démarches, à repeupler de Bénédictines l’ancienne maison de Flavigny, qui devint rapidement par ses soins le plus prospère pensionnat de jeunes filles, il se plongea, pour être digne de diriger ces dames, dans l’étude des maîtres de la vie mystique et des fondateurs d’ordre. Et nul d’eux ne lui plut autant que le grand saint de
Léopold Baillard, à Flavigny, fait peut-être sourire, quand, le cerveau en feu, il se penche sur l’histoire du Bon Père. Il rappelle don Quichotte qui, dans son village désolé de Castille, s’enflamme en lisant les romans de chevalerie et se propose d’égaler Amadis des Gaules. N’empêche qu’un jeune prêtre de vingt-cinq ans, qui emploie à se hausser vers un magnifique modèle d’esprit et de vertu l’émotion reçue d’une communauté de femmes dont il est le bienfaiteur, c’est une belle image du romantisme lorrain.
A cette époque, les ducs que l’on avait tant aimés ayant disparu à l’horizon, et les primes superbes que l’Empereur donnait au courage heureux n’étant plus disponibles, la nation lorraine, diminuée par les malheurs répétés de la guerre et les désillusions de sacrifices sans gloire, commençait à se déshabituer du sentiment de la grandeur. Ce jeune paysan échappe à cette médiocrité. Il a résolu d’aider Dieu en
A quelques lieues de Flavigny, dans Mattaincourt, achevait de s’écrouler la vieille maison du père Fourrier et de sa glorieuse compagne, la mère Allix. Léopold jugea qu’il était de son plus élémentaire devoir de ne pas laisser sans gloire le sanctuaire de son grand patron. Il racheta ces
De toutes parts, un murmure flatteur entourait, enorgueillissait le jeune curé de Flavigny et ses deux frères, qui, chargés chacun de paroisses dans son voisinage, trouvaient le temps de l’assister. Cependant Léopold préssentait qu’il n’avait pas rempli toute sa destinée. Au milieu de ses réussites, il prêtait une oreille attentive aux érudits de Nancy, à tout un petit groupe d’esprits curieux qui se consolaient de vivre sous l’influence de
Il se mit aussitôt en campagne, trouva de l’argent ou plutôt du crédit, et, dans l’année même, acheta les divers lots de terre et de bâtiments qui jadis avaient composé le domaine du pèlerinage. Saint domaine ! Territoire de
Rien n’arrête cet étonnant improvisateur, rien ne l’inquiète. Il n’admet pas que la plante
Vers 1840, sous l’étiquette d’Institut des frères de Notre-Dame de Sion-Vaudémont, la sainte montagne, grâce à l’impulsion des messieurs Baillard, présentait l’image d’une ruche active et industrieuse, où la prière et le travail se succédaient avec bonheur. Beaux bâtiments conventuels, jardins vastes et bien entretenus, ferme modèle au village de Saxon, pensionnat de jeunes gens, grands ateliers pour menuisiers, maréchaux ferrants, charrons, peintres et sculpteurs, tailleurs de pierre, tailleurs d’habits, maçons, fabricants de bas au métier, et même une petite librairie pour la propagande des bons livres. Aux jours de fêtes, de belles cérémonies, des prédications émouvantes, des chants et de la musique attiraient de toutes parts les fidèles éblouis autant qu’édifiés. Et pour couronner la visite de Sion, une surprise charmante était réservée aux plus distingués des pèlerins. Jamais les prêtres ou les laïques considérables qui avaient suivi les pieux offices ne s’en seraient retournés sans être descendus à Saxon. Là, dans la paix profonde du village enfoui au milieu de ses vergers, à l’intérieur de la courbe et pour ainsi dire dans le sein de la colline, ils trouvaient les religieuses, assises sur des bancs à l’ombre de leur couvent. Elles formaient un petit jardin virginal. C’étaient les sœurs quêteuses, celles. du moins qui, pour l’instant, se reposaient entre deux voyages.
Ainsi dans les créations de ces Messieurs, il y avait de quoi émouvoir toutes les sortes d’imagination. A cette époque, en
Juste prudence villageoise. Mais chacun meurt de son génie. Napoléon veut toujours vaincre. Dans les forêts des Vosges et sur les sommets qui séparent
Voilà tout le pays d’entre-Rhin et
Les Baillard eussent été invincibles s’ils s’étaient fait une idée du monde moderne. Ils l’ignoraient totalement. Léopold ne tenait compte des gens qu’autant qu’ils méritaient de prendre place dans le coin d’un vitrail ou d’un tableau en attitude de donateurs. Il parcourait le monde sans rien y remarquer que ce qui aurait pu, tant bien que mal, figurer dans une biographie du Père Fourrier. Ils ne virent pas se former contre eux une terrible coalition de leurs supérieurs hiérarchiques avec les libéraux.
La libre pensée devait détester ces œuvres où le particularisme lorrain s’alliait étroitement à l’idée catholique et qui formaient, à bien voir, des citadelles contre le rationalisme. Quant à l’évêque concordataire, pouvait-il goûter beaucoup cette religion locale ? Il y devinait des mouvements d’illuminisme, un fond trouble, qui apparut quand ce singulier Léopold se crut favorisé d’un miracle en la personne de sœur Thérèse Thiriet.
Les religieuses de Saxon, nous l’avons dit, étaient dévouées corps et âme à Léopold Baillard. C’étaient des jeunes paysannes du pays, qu’il avait d’abord placées auprès des religieuses de Mattaincourt. Mais ces dames trouvèrent ces simples filles bien grossières et les traitèrent en servantes. Léopold voyant qu’elles n’étaient pas heureuses les fit revenir, les organisa près de lui en petite communauté, composa pour elles un règlement et les employa pour ses quêtes. Elles lui vouèrent une grande reconnaissance et reportèrent à lui seul toutes leurs pensées, Leur métier même les y invitait. N’avaient-elles pas à faire son éloge tout le jour ? N’était-ce pas entre ses mains qu’elles apportaient l’argent, et de sa bouche qu’elles attendaient une approbation ? Entre elles régnait une constante émulation pour lui plaire. Et tout cela avait produit des personnes tout à fait rares, mais qui n’avaient en définitive pour règle certaine que la seule volonté de Léopold. A leur tête marchait la sœur Thérèse. Active, intelligente et gracieuse, cette religieuse exceptionnelle avait fait le succès de Notre-Dame de Sion à travers toute l’Europe. Léopold, qui vivait les yeux fixés sur la biographie des saints, se figurait qu’elle tenait auprès de lui le rôle admirable qu’a joué la mère Allix aux côtés de Pierre Fourrier. De fait, elle était le grand instrument financier de son œuvre. Or il advint qu’elle tomba malade, et durant plusieurs mois ne put bouger de son lit. L’argent se faisait rare. Dans cette extrémité, Léopold ne put résister à l’attrait du surnaturel, et considérant que la malade avait tant fait pour Notre-Dame que celle-ci pouvait bien le lui rendre, il la fit porter devant la statue miraculeuse. O merveille ! Aussitôt déposée dans le chœur de la chapelle, la religieuse se leva et se mit marcher.
L’évêque de Nancy ne voulut pas ordonner une enquête sur ce miracle, et le médecin de Vézelise refusa un certificat à la malade. Cet accord de l’Église et de la libre pensée contre les Baillard était grave, mais eux, sans prendre souci des nuages qui s’amassaient des deux côtés de l’horizon poussaient toujours de l’avant et se livraient à un désir immodéré d’élévation.
Léopold Baillard avait l’âme très haute ; le choix des œuvres auxquelles il s’appliqua est à cet égard tout à fait révélateur. Mais pour réaliser nos desseins les plus purs, nous sommes bien obligés de recourir à des moyens humains qui peuvent être détestables. J’ai tenu dans mes mains les comptes des Baillard ; on y assiste, jour par jour et morceau par morceau, à la constitution de chacun des beaux domaines où ils satisfaisaient tout ensemble leur instinct de paysan pour la terre et leur sentiment de l’idéal. C’est à la fois admirable et bien fâcheux. Rien de plus inquiétant que certaines pages de ces registres où l’on voit l’audace spéciale de ces Messieurs, et comment des messes qui leur étaient payées trois francs, ils les revendaient, les faisaient dire pour dix sous.
L’évêque, inquiet des bruits qui couraient sur les folles dépenses, les charges et les expédients des trois prêtres, voulut s’immiscer dans leurs affaires. Ils se crurent atteints dans leur honneur sacerdotal et dans leurs intérêts vitaux. L’Institut qu’ils présidaient, n’était-ce donc pas leur création ?
L’interdiction de faire des quêtes mit les Baillard dans l’impossibilité de soutenir, au jour le jour, leurs frais immenses et de remplir leurs engagements pour tous ces domaines achetés à crédit. Les créanciers assiégèrent leur porte, les contraignirent à des ventes désastreuses. Le domaine de Sainte-Odile, la ferme de Saxon, les terres de Sion furent mis aux enchères. Ces grands biens. que l’on estimait trois cent cinquante mille francs, ne firent pas cent vingt mille, parce que les événements de 1848 venaient de déprécier les terres et surtout les biens conventuels. Dans cette débâcle, le patrimoine des Baillard disparut. Et par surcroît, leur honneur de prêtre ne demeura pas intact. En effet, sur l’affiche de vente des biens de Sainte-Odile, au scandale universel, on put voir, entre le cheptel et les bâtiments des granges, les reliques de la sainte patronne de l’Alsace livrées à l’encan.
C’est l’Église elle-même qui jugea nécessaire de venir donner à son champion Léopold le coup de mort. Il subit un dur traitement, un traitement, injuste si l’on regarde ses étals de service, mais qu’il fallait qu’on lui appliquât pour protéger un plus vaste ensemble. Dans le moment où se consommait la ruine matérielle de Léopold Baillard, l’évêque lui enleva son titre de Supérieur général de
Quel naufrage ! A cinquante ans, à l’âge normal des récoltes, le fondateur de Flavigny, de Mattaincourt, de Sainte-Odile, le Supérieur des Frères de Sion-Vaudémont n’est plus rien que le curé de la toute petite paroisse de Saxon, où l’assistent ses deux cadets François et Quirin. De leur temporel, de tout ce qu’ils ont construit avec tant de peine, à la sueur de leur front et au prix même de leur patrimoine, c’est tout juste si les trois frères peuvent, sous le prête-nom de quelques pauvres sœurs demeurées fidèles, sauver le couvent de Sion pour leur servir d’abri. De leur spirituel, rien ne leur reste que le droit de dire la messe, et voici que l’évêque, pour en finir, va le leur arracher et déjà lève la main…
Léopold s’attarde au lieu de se courber. Il cherche à retenir ses sujets, tous ces frères et toutes ces sœurs qui fuient sa ruine, qui glissent sur les pentes de Sion, qui s’envolent comme des feuilles d’automne. Voilà qu’il veut solliciter du peuple cette désignation, ce droit mystique que ses chefs lui retirent. En 1848, il se présente à la députation. Qu’il soit l’élu de la nation
Le prélat vainqueur entonne l'Alleluia. Il proclame la bonne nouvelle. Il pardonnera. Il daigne relever de toutes censures ces trois enfants prodigues, mais pour retremper leurs esprits, pour les laver de la poussière du siècle, selon un usage constant à l’issue de ces grandes crises, il leur ordonne, en juillet 1850, d’aller faire une retraite à la chartreuse de Bosserville. Il plonge ces âmes brûlantes dans la tranquillité du cloître comme un fer rouge dans l’eau froide.
Ainsi finit la vie publique des trois frères Baillard. C’est à partir de ce moment que s’installe sur eux ce silence hostile, ce mystère qui m’avait tant frappé quand j’entendis, pour les premières fois, prononcer à voix basse leurs noms. Suivons-les, entrons sur cette arrière-scène de plus en plus obscurcie, où quelques rares témoins les ont vus prolonger des vies de plus en plus singulières.
Произведения
Критика