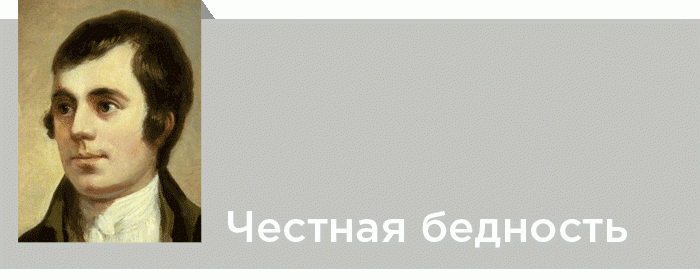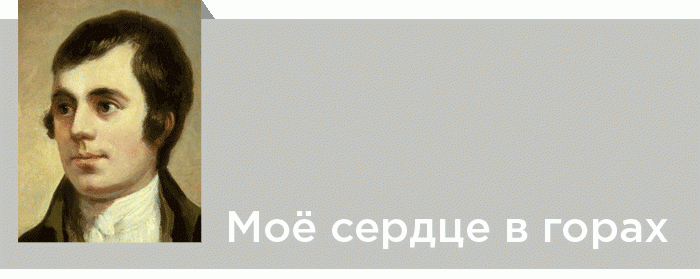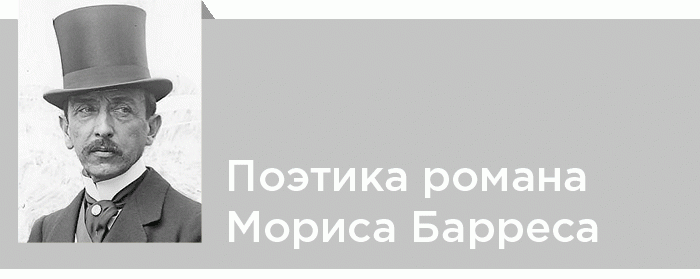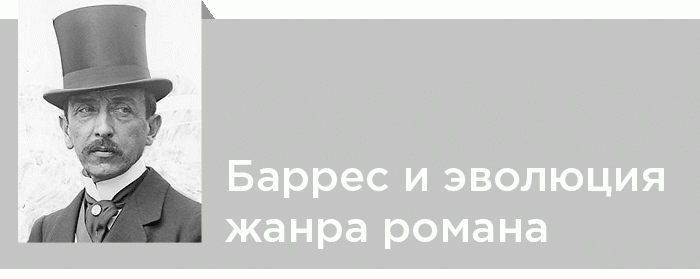Морис Баррес. Колетта Бодош
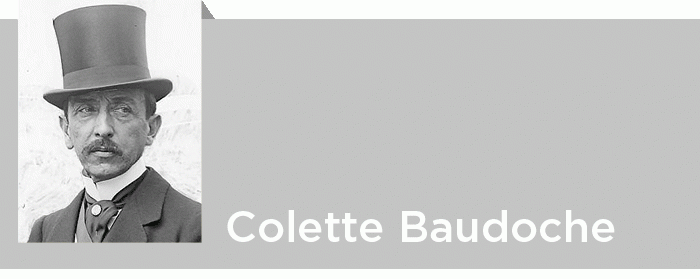
(Отрывок)
HISTOIRE D'UNE JEUNE FILLE DE
Il n’y a pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz. Un Messin français à qui l’on rappelle sa cathédrale, l’Esplanade, les rues étroites aux noms familiers,
Les statues de Fabert et de Ney, que sont venues rejoindre celles de Guillaume Ier et de Frédéric-Charles, étaient entourées du prestige qu’on accorde aux
Les Messins d’avant la guerre, tous soldats ou parents de soldats, vivaient en rapports journaliers avec la région agricole. Les rentiers y avaient leurs fermes, les marchands leurs acheteurs, et la plus modeste famille rêvait d’une maison de campagne où, chaque automne, on irait surveiller la vendange.
Tout cela composait une atmosphère très propre â la conservation du vieux type français. Qui n’a pas connu, médité cette ville, ignore peut-être la valeur d’une civilisation formée dans les mœurs de l’agriculture et de la guerre. Les Lorrains émigrés ne regrettent pas simplement des paysages, des habitudes, une société dispersée, ils croient avoir laissé derrière eux quelque chose de leur santé morale.
Jamais je ne passe le seuil de cette ville désaffectée sans qu’elle me ramène au sentiment de nos destinées interrompues.
Tout autour de ce haut lieu, le flot germain monte sans cesse et menace de tout submerger. Au nombre de vingt-quatre mille (sans compter la garnison), les immigrés dominent électoralement les vingt mille indigènes. Sous l’effort de cette inondation, l’édifice français va-t-il être emporté ? Le voyageur qui arrive aujourd’hui à
La gare neuve où l’on débarque affiche la ferme volonté de créer un style de l’empire, le style colossâl, comme ils disent en s’attardant sur la dernière syllabe. Elle nous étonne par son style roman et par un clocher, qu’a dessiné, dit-on, Guillaume II, mais rien ne s’élance, tout est retenu, accroupi, tassé sous un couvercle d’un prodigieux vert-épinard. On y salue une ambition digne d’une cathédrale, et ce n’est qu’une tourte, un immense pâté de viande. La prétention et le manque de goût apparaissent mieux encore dans les détails. N’a-t-on pas imaginé de rappeler dans chacun des motifs ornementaux la destination de l’édifice ! En artistes véridiques, nous autres, loyaux Germains, pour amuser nos sérieuses populations, qui viennent prendre un billet de chemin de fer, nous leur présenterons dans nos chapiteaux des têtes de soldats casquées de pointes, des figures d’employés aux moustaches stylisées, des locomotives, des douaniers examinant le sac d’un voyageur, enfin un vieux monsieur, en chapeau haut de forme, qui pleure de quitter son petit-fils… Cette série de platitudes, produit d’une conception philosophique, vous n’en doutez pas, pourrait tant bien que mal se soutenir à coups de raisonnements, mais nul homme de goût ne les excusera, s’il a vue leur morne moralité.
Au sortir de la gare, on tombe dans un quartier tout neuf, où des centaines de maisons chaotiques nous allèchent d’abord par leur couleur café au lait, chocolat ou thé, révélant chez les architectes germains une prédilection pour les aspects comestibles. Je n’y vois nulle large, franche et belle avenue qui nous mène à la ville, mais une même folie des grandeurs déchaîne d’énormes caravansérails et des villas bourgeoises, encombrées de sculptures économiques et tapageuses. En voici aux façades boisées et bariolées à l’alsacienne, que flanquent des tourelles trop pointues pour qu’on y pénètre. En voilà de tendance Louis XVI, mais bâties en
Je ne ressens aucune émotion de force devant ces façades à
Dans un coin de cet immense cauchemar, en contre-bas, sous un pourrissoir de vieux paniers et de seaux bosselés, n’est-ce pas l’ancienne porte Saint-Tiébaud ? Ah ! qu’ils la démolissent, qu’ils lui donnent le coup de grâce, à cette martyre !
On reprend pied, on respire, sitôt franchie la ligne des anciens remparts. Je ne dis pas que ces maisons petites, très usagées, avec leurs volets commodes et parfois des balcons en fer forgé, soient belles, mais elles ne font pas rire d’elles. De simples gens ont construit ces demeures à leur image, et voulant vivre paisiblement une vie messine, ils n’ont pas eu souci de chercher des modèles dans tous les siècles et par tous les climats. Voyez, au pied de l’Esplanade, comme les honnêtes bâtiments de l’ancienne poudrerie, recouverts de grands arbres et baignés par
Certains quartiers pourtant demeurent intacts : Mazelle, le Haut de Sainte-Croix et les quais où l’on retrouve les aspects éternels de Metz. Les paysans viennent toujours porter aux vieux moulins le blé de
Suis-je dupe d’une illusion, d’une rêverie de mon cœur prévenu ? Dans le réseau de ces rues étroites, où les vieux noms sur les boutiques me donnent du plaisir, je crois sentir la simplicité des anciennes mœurs polies et ces vertus d’humilité, de dignité, qui, chez nos pères, s’accordaient. J’y goûte la froideur salubre des disciplines de jadis, mêlées d’humour et si différentes de la contrainte prussienne. Un attendrissement nous gagne dans ces vieilles parties de Metz, où dominent aujourd’hui les femmes et les enfants. Elles avivent notre don de spiritualité. Elles nous ramènent vers
Un jour que je me prêtais à ces influences du vieux Metz, le long de
Personne ne le regardait. Il n’éveillait ni l’instinct comique, ni l’hostilité. Il paraissait vraiment banal : un Prussien de plus arrivait, une goutte d’eau dans ce déluge.
Autour de lui, c’était la rivière glissante, ses tilleuls, l’île aux grands arbres que l’on appelle du nom charmant de Jardin d’Amour, la rumeur des moulins et les jeux des petits polissons : tout le vieux
Ce qui fournit la matière de tant de livres importants sur l’histoire, sur les races, sur les destinées de
Le hasard qui m’avait permis d’assister au débarquement de ce jeune Prussien a continué de me favoriser. J’ai pu connaître l’emploi de son temps au cours de sa première année messine. C’est tout un petit roman, plein de sens, qui éclaire d’un jour net et froid l’état des choses franco-allemandes en
Bernardin de Saint-Pierre admire que le célèbre Poussin, quand il peignit le Déluge, se soit borné à faire voir une famille qui lutte contre la catastrophe. Pas n’est besoin de grandes machines. À ceux qui liront le drame sans gloire dont une heureuse fortune m’a fait le confident, je crois que je rendrai sensible la position pathétique de
Cependant, le jeune étranger était entré dans la maison. Au premier étage, une jeune fille lui ouvrit, une demoiselle très simplement vêtue. Il demanda en allemand à voir ce qui était à louer. Elle répondit en français qu’elle allait prévenir sa grand’mère. Et le laissant dans le corridor, elle disparut avec la prestesse d’une jeune chèvre.
– Ce sont des
Madame Baudoche était en train de coudre une robe pour une voisine, dans une des chambres garnies. Bien qu’elle fût contrariée de montrer du désordre à l’étranger, elle ne voulut pas le laisser debout dans le couloir, et, d’une très bonne manière, elle le pria d’entrer, de s’asseoir, puis, sans hâte, et l’ayant bien examiné, elle lui fit visiter les deux belles chambres sur la rue, dont elle demandait cinquante marks par mois :
– Vous voyez, disait-elle, que vous serez bien chez vous. Le corridor coupe en deux l’appartement : vous d’un côté, et nous de l’autre, avec la cuisine et les deux chambres que ma petite-fille et moi habitons… Vous aurez un lit à la française et non pas un de ces lits avec des draps comme des mouchoirs… Quel métier faites-vous ? Professeur ? Vous n’avez qu’à passer deux fois
En effet, un jeune homme ne pourrait pas trouver, dans
D’un ton calme et sérieux, en s’aidant çà et là de quelques mots allemands, il raconte qu’il arrive de Kœnigsberg, qu’il a vingt-cinq ans, qu’il ne gagne encore que deux mille deux cents marks, mais qu’il sera bientôt Oberlehrer, avec un traitement de trois mille marks au moins. Il est mis en confiance par cette atmosphère de modeste intimité, dont un Allemand ne peut pas se passer. Amplement, naïvement, il raconte tout ce, qui le concerne. Sa lenteur met un peu d’ennui dans cette chambre, pleine du joli soleil de septembre ; Madame Baudoche frotte avec la paume de sa main la belle armoire lorraine, bien brodée et de chêne éclatant ; mais après une longue nuit de chemin de fer, le brave garçon paraît ne sentir l’ennui que comme un repos, et l’aimable logeuse doit enfin lui rappeler qu’il a sans doute laissé un bagage à la gare.
Elle l’accompagne sur le palier :
– A tout à l’heure, Monsieur.
– Monsieur le docteur, précise-t-il avec ingénuité, en rappelant le titre auquel il a droit.
Sous le pas qui s’éloigne, l’escalier de bois gémit, et la jeune Colette réapparaît tout égayée de malice :
– Est-il assez lourdaud, Monsieur le docteur ! Quelles bottes et quelle cravate !
– Dame ! répond la grand’mère, il est à la mode de Kœnigsberg.
De leur fenêtre, les deux femmes le regardent jusqu’à ce qu’il ait tourné dans la rue de
– Crois-tu qu’il revienne ? dit la vieille dame. J’aurais peut-être dû lui demander un acompte.
Elles se rassurèrent en jugeant qu’il avait l’air honnête. Et d’ailleurs pour cinquante marks, où trouverait-il deux chambres aussi confortables ?
Madame Baudoche apporte des draps frais au lit de l’étranger, tandis que sa petite-fille approvisionne d’eau la toilette et déménage le mannequin, avec les corbeilles de couture, dans la salle à manger.
Ce n’est pas sans regret que les deux femmes habiteront, sur l’autre côté du corridor, deux pièces moins bien éclairées. La vue de
– Ah ! soupire Madame Baudoche, quelle humiliation pour ton pauvre père, s’il avait imaginé qu’un jour je céderais une partie de l’appartement. Et à qui ? à un Prussien !
– Aujourd’hui, dit la jeune fille, il n’y a qu’eux pour louer des chambres meublées. Personne ne pensera à nous mal juger. Mais si tu veux, nous pouvons encore le refuser.
– Eh non ! fit la grand’mère. Il m’ennuie, mais je l’ai trop désiré.
Pour comprendre cette exclamation, où s’affirmait le vigoureux bon sens de Madame Baudoche, il faut connaître la fortune précaire des deux femmes. Elles vivaient d’une rente de douze cents francs, que leur faisait une famille messine, émigrée à Paris, les V…, en souvenir du père et du grand-père de Colette, qui avaient géré avec une grande honnêteté, puis liquidé au mieux ses immeubles de Metz et son beau domaine de Gorze. À cette pension, les dames Baudoche joignaient le mince produit de quelques travaux de couture ; et pour tirer parti de leur appartement, elles venaient de meubler et de mettre en location les deux meilleures chambres. Mais depuis six mois, personne ne s’était présenté. C’est dire de quel grave souci les allégeait la venue de M. Asmus.
En attendant qu’il réapparût, Madame Baudoche se mit à refaire avec un plaisir franc ses calculs : le Prussien donnerait six cents marks qui payeraient tout le loyer et laisseraient encore un bénéfice de cent marks, pour la dot de Colette. La vieille femme ne se lassait pas de reprendre un rêve, toujours le même, au bout duquel il y avait un mariage pour sa petite-fille avec quelque honnête Messin et le jeune ménage occupant auprès d’elle les fameuses chambres du quai. Elle s’expliquait sans phrases émues (tout en drapant sur le mannequin leur commun ouvrage) avec des mots précis et fermes, qui pourraient sembler trop positifs, mais sous lesquels vivait toujours quelque chose de profond. Et c’était charmant de voir cette grand’mère et cette fille, l’une solide de toutes manières et qui a le poids de l’expérience, l’autre faite à sa ressemblance, mais plus mince de corps et plus vive de ton, mûrir ce modeste bonheur et s’orienter, sans le savoir, à reconstruire dans
Mieux encore que leur dialogue, gêné d’ailleurs par les épingles qu’elles serraient entre leurs lèvres, toute la disposition de ce modeste appartement rendait sensible l’accord heureux des deux femmes.
Chaque dix minutes, elles viennent se pencher à la fenêtre. Vers cinq heures, elles n’en bougèrent plus. Et, comme elles avaient cessé de travailler, elles cessèrent de causer. Une voisine, depuis la rue, leur demanda si l’Allemand qu’on avait vu monter louait. Elles firent un geste d’incertitude.
Il n’y avait plus sur le quai que deux, trois pêcheurs à la ligne, et une paire de chiens flâneurs. Derrière
– Eh bien ! dit la grand’mère tristement, il ne revient pas.
– Tant mieux, maman ; il nous aurait empêchées de nous sentir chez nous !
Ces pauvres mots étaient l’abrégé de tout un monde de sentiments, mais si mesurés qu’il faut connaître le manque de déclamation des Lorrains pour en distinguer la tendresse.
Elles se retiraient, quand, soudain, toutes deux joyeusement s’écrièrent :
– Le voilà !
L’homme au chapeau verdâtre s’avançait suivi d’un commissionnaire qui poussait deux malles sur une charrette. Et lui-même, enchanté, loyal, gigantesque, tenait soigneusement un petit paquet.
Deux minutes plus tard, quand il eut gravi l’escalier retentissant, il déplia ce paquet devant les deux dames. C’était de la charcuterie, et il demanda en français si l’on pouvait lui chercher de la bière.
Le lendemain matin, M. Frédéric Asmus déballa ses deux malles, dont la plus grande ne contenait que des livres, et, l’après-midi, vêtu de sa belle redingote, il fit ses visites officielles. Le même jour, il loua un piano pour douze francs cinquante par mois. Cette acquisition obligeait à bouleverser tout le cabinet de travail, et Madame Baudoche, qui tenait à ses meubles, voulut diriger la manœuvre. Les ouvriers partis, elle dut admirer vingt-cinq photographies que l’Allemand avait dispersées sur les murs, la cheminée et les tables.
– Voilà mon père, disait-il ; voici ma mère, mes sœurs, mes frères et ma fiancée.
Sur ce dernier mot, la jeune Colette apparut.
M. Asmus possédait cinq portraits différents de sa fiancée ; mais le plus à son goût, il l’avait placé près de lui sur sa table à écrire.
C’était une femme de vingt-cinq ans, une belle Walkyrie.
– Elle est très intelligente, disait-il. N’est-ce pas que cela se voit dans son regard si ferme ?
Ils étaient deux camarades d’enfance, et il aurait voulu que le mariage se fît dès maintenant. Un de ses oncles s’offrait à les aider d’une petite rente provisoire.
– C’est ma fiancée qui a eu des scrupules. Plusieurs fois, en causant, nous nous sommes aperçus qu’elle avait une connaissance des choses et des gens, une maturité plus grande que la mienne. Alors elle s’est demandé s’il était bien raisonnable que nous nous épousions tout de suite. C’est une chose certaine qu’il est nécessaire, pour le bonheur, que le mari soit supérieur à la femme et que celle-ci trouve en lui, chaque jour, des motifs nouveaux de l’estimer et de s’enorgueillir. J’ai dû me rendre à ses raisons. Oui, je dois acquérir dans la pratique de la vie plus d’expérience, afin que je n’aie pas à rougir devant elle.
La petite Messine, qui le regardait avec effarement, l’interrompit d’un mot du cœur:
– Vous l’aimez bien pourtant, Monsieur le docteur ?
Madame Baudoche admira combien les jeunes gens de Kœnigsberg étaient sages. Et lui, il ne se douta pas que les deux femmes le quittaient pour mieux rire. En achevant d’installer ses livres, il se réjouissait de s’être si bien fait comprendre.
Lorsqu’on apprit, dans le petit monde de clientes et de voisines où vivaient les dames Baudoche, qu’elles avaient loué à un Allemand, on vint se renseigner, les interroger. Colette raconta quel drôle de fiancé était ce professeur. Il arriva juste au milieu de leurs éclats, et la jeune fille lui dit :
– Il faut que je vous présente notre voisine, Madame Krauss. Elle habite l’étage au-dessus. Vous rencontrerez quelquefois chez nous son petit garçon et sa petite fille, qu’elle nous laisse quand elle travaille dehors.
Le professeur expliqua comment, à Kœnigsberg, les demoiselles de bonne famille passent une partie de leurs journées à garder, dans des jardins, les enfants des pauvres qui sont à leur travail.
– Votre fiancée s’en occupe ?
– Oui, Mademoiselle ; de cette manière, elle a pu acquérir une grande connaissance des caractères, et, comme je vous ai dit, l’expérience de la vie.
– Eh bien ! repartit Colette, je vous ferai connaître les deux bons petits Krauss : un garçon de cinq ans et une fille de huit. Ils vous donneront, tant que vous voudrez, l’expérience de la vie, en français ou en allemand, à votre choix.
Et ces
Toutefois, l’une et l’autre s’accordaient à trouver qu’il était un animal de la grosse espèce. Tandis qu’elles prenaient des précautions pour ne pas gêner son travail, lui, entre onze heures et minuit, il rentrait sans savoir qu’il faisait claquer les trois portes de la rue, de l’appartement et de sa chambre. Les services qu’il désirait, il les avait énumérés comme les articles d’un règlement. A midi, il mangeait au restaurant avec ses collègues ; le soir, ces dames lui procuraient de la charcuterie, du thé ou de la bière ; chaque matin, à sept heures, Madame Baudoche devait lui apporter son café au lait dans sa chambre. Le troisième jour, il lui dit :
– Madame Baudoche, je vous ferai observer que vous êtes en retard de quatre minutes.
– Ce sont tous des pédants, déclara-t-elle à sa fille.
La vieille Messine avait trouvé le mot juste. Et précisément ce dimanche matin, M. Asmus avait rendez-vous avec des collègues pour une partie de pédantisme.
Ces messieurs voulaient l’initier méthodiquement au pays messin. Et, fidèles au principe qui veut qu’un voyageur, dans une ville nouvelle, monte d’abord au clocher, ils avaient projeté de gagner le haut village de Scy.
Vers neuf heures, tandis que la grand’messe sonnait à toutes les paroisses, ils gravirent les pentes du fort Saint-Quentin, au milieu des vignes et des ronces ; et parfois, le long des murs, la clématite embaumée et les poiriers lourds de fruits se penchaient. Quelques paysans qu’ils croisèrent dans l’étroit sentier pierreux plaisantaient, causaient en français, ce qui étonna M. Asmus. Ses amis lui dirent :
– Ces gens-là ! Ils apprennent l’allemand à l’école, puis ils vont au régiment ; eh bien ! rentrés chez eux, ils se mettent à parler leur patois français.
Ils ajoutèrent à cette explication des propos violents contre les indigènes, et l’on voyait que le traité de Francfort n’a pas mis fin à la guerre dans le pays messin.
Ces professeurs étaient tous venus en
M. Asmus ne demandait qu’à s’enorgueillir avec ses compagnons de la victoire de leurs pères, mais il se préoccupait surtout d’en tirer parti, et quand le pangermaniste cherchait le meilleur moyen d’empêcher les Lorrains de parler leur langue, il aurait trouvé plus intéressant qu’on lui dît de quelle manière il pourrait les fréquenter et perfectionner son français.
Ils gagnèrent ainsi l’étroite terrasse où la petite église, couverte de ses longues ardoises, est assise au milieu d’arbres ébouriffés.
Devant eux s’étendait un pays à la mesure humaine, vaste sans immensité, façonné et souple, et, près de sa rivière, Metz, toute plate au ras de la plaine, et que spiritualise le vaisseau de sa haute cathédrale.
Cette fin de septembre est l’époque la plus charmante de
Ils n’en comprirent pas la délicatesse et s’accordèrent à proclamer qu’ils avaient dans la vieille Allemagne de plus grands paysages.
Il manquait à ces jeunes gens, venus d’un ciel où
Ce premier dimanche qu’il monta sur le plateau de Scy, le professeur Asmus, mal éveillé à cette nouvelle atmosphère, gardait une solide santé allemande. Il ne subissait pas encore cette électricité
Au Rhin, au Rhin, ne va pas au Rhin,
Mon fils, mon conseil est bon.
La vie t’y paraîtra trop douce,
Ton humeur y deviendra trop joyeuse.
Tu y verras des filles si vives et des hommes si assurés !
Comme s’ils étaient de race noble !
Ton âme, ardemment, y prendra goût,
Et il te semblera que ce soit juste et bien.
Et dans le fleuve la nymphe surgira des profondeurs,
Et quand tu auras vu son sourire,
Quand
Mon fils, tu seras perdu.
Le son t’ensorcellera, l’apparence te trompera,
Tu seras pris d’enchantement et de terreur,
Tu ne cesseras plus de chanter : au Rhin ! au Rhin !
Et tu ne retourneras plus chez les tiens.
Cette chanson exprime le rapport de ces jeunes Allemands avec cette vallée d’une manière plus profonde que M. Asmus ne peut le savoir à cette heure. Mais cette terre nouvelle va très vite l’avertir. Il écoute, regarde ; tout l’intéresse ; il porte ici la complaisance de ces pèlerins du Nord qui, descendus vers les contrées bénies, sur la rive du lac de Garde, s’émerveillent des premiers oliviers.
Un jour que M. Asmus traversait le Jardin d’Amour, il s’arrêta pour y regarder la récréation des enfants : beaucoup de petites figures encore villageoises, coiffées de casquettes ; des tabliers bleus, leur effroi : de longs cache-nez. Ils formaient dans cet espace assez étroit, sous les grands arbres auprès de
Frédéric Asmus admirait cette vivacité et cette gentillesse avec un cœur pacifique de géant. Dans cette diablerie lorraine, il ne reconnaissait pas encore un des Callot qu’il examinait, chaque jour, à une vitrine de la rue des Jardins, soit
Mais soudain l’un d’eux vint à glisser et parut s’être blessé. Ses camarades, qui l’avaient poussé, l’entourèrent en baissant la voix. L’Allemand s’approcha et dit en français :
– As-tu mal ?
– Non, non, répondit vivement l’enfant.
C’était un joli petit Messin, mais déjà avec le regard de l’homme qui ne se laisse pas molester. Il avait sous le nez et sur le menton deux moustaches et une magnifique impériale, tracées avec un bouchon brûlé, comme c’est l’usage des gamins de
– N’aie pas peur… Sais-tu bien qui je suis ?
Il voulait faire entendre qu’il était un maître, un ami des enfants, mais le petit Lorrain de répondre :
– Toi, tu es le Prussien de chez Madame Baudoche.
Ce mot et les rires, qui l’avaient accueilli furent la première expérience
«Mes collègues, lui écrivait-il, m’avaient un peu choqué, l’autre matin, durant la promenade que je t’ai racontée, par leur malveillance envers les habitants de ce pays. Mais voici que ma petite aventure avec ce gamin me fait reconnaître qu’ils raisonnent sur des faits. T’avouerai-je que les rires de ces badauds n’ont pas été sans m’attrister ? Je laisse de côté la question du ridicule personnel ; mais j’ai vu méprisé un sincère mouvement de mon cœur. Je crois qu’ici l’on se moque de tout.»
Pourtant ce n’était là qu’une note isolée au milieu des sensations agréables que M. Asmus recevait de toutes parts.
Des détails matériels qui ne disent rien aux indigènes l’étonnaient et l’enchantaient. Ainsi le premier feu de bois qu’à la fin de septembre il alluma dans sa cheminée. Pour ce Prussien qui n’a jamais vu que des poêles, c’est une nouveauté et un plaisir de corriger les copies de ses élèves, assis dans un commode fauteuil Empire, tandis qu’une douce flambée anime et fait briller les meubles bien frottés. Assurément, s’il jouit de la bonne aération de sa chambre, ce n’est pas qu’il en soit déjà à mépriser la sauvage coutume de ses compatriotes qui, dépourvus de draps et de couvertures, transpirent depuis des générations sous le même édredon immense. Et de même, s’il se plaît à promener son regard dans un logement où les murs n’offrent pas des assiettes en carton décorées d’hirondelles, où la cheminée ne s’enorgueillit pas d’hommes illustres en plâtre badigeonnés de bronze, où même fait défaut le fameux bouquet Mackart, composé de grandes gerbes qu’affectionne la poussière, ce n’est point qu’il se rende compte de l’absurdité de ses compatriotes, qui ont la manie de tout couvrir d’une camelote de bazar où l’œil ne s’accroche à rien. Mais à son insu, dans ce garni messin, il subit l’agrément d’une certaine supériorité d’hygiène et de goût. Et à vrai dire, il n’y fallait pas voir une réussite de l’excellente Madame Baudoche, mais plutôt l’effet modeste d’une vieille civilisation.
Le caractère de cet intérieur était donné par une armoire lorraine, en beau noyer bien poli, de style Louis XV, avec ses portes moulurées, ses minces fleurs sculptées en relief et ses longues entrées de serrure en fer ajouré. M. Asmus n’était pas à même de goûter ce chef-d’œuvre de menuiserie fine et rustique. Mais il avait remarqué, dès le premier moment, sa pendule où Napoléon tenait le petit roi de Rome sur ses genoux, et aux murailles quatre belles gravures : le Serment du jeu de Paume par David, un portrait de M. Thiers, libérateur du territoire, et puis deux belles œuvres d’un artiste romantique, peu connu hors de sa ville natale, Aimé de Lemud, représentant, l’une, un jeune Callot qu’une belle bohémienne entraîne vers l’Italie, l’autre, le Cercueil de l’Empereur porté sur les épaules de ses grenadiers et qu’accompagne, comme un vol d’ombres,
M. Asmus trouvait pittoresque, amusant, d’être enveloppé d’images françaises, comme d’avoir les oreilles battues par des mots français. Il attendait un grand profit de cette atmosphère si nouvelle. Jusqu’au fond de sa chambre, il participait à la vie de ce vieux quartier, à l’animation du quai et de la rivière. Il aimait à regarder le frémissement de l’eau, les grandes herbes mouvantes, les barques et les brouillards. Et quand il travaillait à sa table, il avait encore une complaisance pour le bruit de la fontaine emplissant le seau des servantes, pour les ébats des gamins et même pour l’aboiement des bons chiens autour de leur maître. Il s’exerçait à reconnaître le martèlement discipliné du pas germain ou le glissement plus libre des indigènes. Il écoutait sans impatience, à travers la cloison, le bruit régulier de la machine à coudre des dames Baudoche, et multipliait les occasions de frapper à leur porte, de leur demander un objet, un petit service.
– Qu’il est indiscret ! pensait la vieille dame.
Mais elle mettait son amour-propre de ménagère à ce qu’il ne manquât de rien, cependant que la jeune Colette disait avec bonne grâce les bonjours et les bonsoirs classiques.
Cette urbanité trompait M. Asmus qui n’était pas né pour comprendre les nuances. Avec sa bonne nature un peu épaisse, mal dégrossie, il appartenait à cette espèce de fâcheux qui croient que la franchise et la cordialité ont tous les droits. Peut-être aussi jugeait-il qu’un professeur honore une loueuse de garni, s’il veut créer avec elle une honnête familiarité.
Parfois, à la fin de la journée, il faisait une promenade. Il sortait de la ville et s’en allait seul, au hasard, dans les proches alentours. Il marchait volontiers de long de
C’était l’heure qu’il choisissait le plus volontiers pour écrire à sa fiancée, en attendant que Madame Baudoche lui apportât son thé et sa charcuterie. A cet instant du souper, la vieille dame se laissait aller à causer avec plus d’abondance. M. Asmus faisait des phrases pour employer les mots de son vocabulaire. Il priait qu’elle les rectifiât, et s’exclamait sur les délicatesses de la langue. Le tout avec un tel plaisir qu’il eût volontiers oublié que ses collègues l’attendaient à la brasserie.
Un soir, l’heure venue de les rejoindre, il ouvrait la porte du palier pour sortir, quand une petite fille se glissa dans le corridor, comme une souris, suivie d’un plus petit garçon. Il saisit le bonhomme par la main et commença de lui demander son nom. Mais l’enfant l’entraîna vers la cuisine, et, sur le seuil, M. Asmus aperçut Mademoiselle Colette, toute rougie par la pleine lumière du fourneau, et qui, sans s’interrompre de casser des œufs, dit gaiement :
– Tu ne crains pas le Monsieur : ta maman vous a déjà conduits à l’autel de saint Blaise, qui guérit de la peur.
Les deux enfants, muets et serrés contre leur amie, surveillaient, avec une extrême vivacité du regard, les mouvements de l’étranger.
– Ce sont les petits Krauss, expliqua la jeune fille. Leur père est votre compatriote. Il a épousé une Messine que vous connaissez déjà. Aujourd’hui, elle est dehors, et je leur prépare une fameuse soupe. Colette avait le don de plaire et d’éveiller un sourire sur le visage de tous ceux qui la regardaient. Ce digne et loyal Germain, qui n’avait jamais cherché auprès de cette petite
« Cela, c’est une scène digne d’une jeune fille allemande. »
Sur la fin du mois, en réglant son premier terme, M. Asmus demanda à Madame Baudoche s’il ne pourrait pas, de temps à autre, après le souper, venir faire un bout de causerie. La logeuse craignit, si elle repoussait ce désir, que l’Allemand n’émigrât dans les quartiers neufs ; et le seize octobre, vers huit heures et demie, M. Frédéric Asmus, au lieu d’aller à la brasserie, passa dans la salle à manger de ces dames, qui avaient terminé leur repas et mis en ordre leur ménage.
Tous trois s’assirent autour de la table ronde et sous la lueur de la lampe. Le professeur avait fait monter de la bière : il en offrit à ses hôtes, qui n’acceptèrent pas. Colette avait enlevé son tablier de travail ; elle était penchée sur un ouvrage de couture, et la lumière l’éclairait doucement. La grand’mère, de temps à autre, interrompait sa besogne pour regarder l’étranger et marquer quelque sympathie à ses efforts de prononciation. Et lui, sa pipe à la main, en face d’une cruche de bière, dont le couvercle d’étain portait gravés les insignes de son ancienne corporation d’étudiants, il faisait vraiment un prodigieux bibelot.
La conversation fut d’abord difficile. Mais M. Asmus fixant les yeux sur le vaisselier, couvert de belles assiettes et gloire de la pièce, fit une remarque. Il observa que les volets et les tiroirs étaient ornés des mêmes pampres que l’armoire de sa chambre. Ce fut une occasion pour Madame Baudoche d’expliquer que le mobilier populaire lorrain se compose de l’armoire, du vaisselier, du pétrin, de la table, du lit et des chaises, et qu’il emprunte ses motifs décoratifs à la flore du pays.
Au château de Gorze, certes, la famille de V… possédait des meubles en bois de rose et de violette ; et il en allait de même dans toutes les grandes familles messines ; mais les gens de goût appréciaient aussi les meubles de campagne bien construits.
M. Asmus, qui s’était levé pour mieux examiner le bahut et les assiettes, dit que tout cela ressemblait à l’art populaire allemand.
– Ah ! vous croyez ! s’écrièrent les dames.
II y eut un silence que M. Asmus eut peine à comprendre. Il revint s’asseoir muet et réfléchissant.
Après quelques tâtonnements,
– Monsieur Asmus, demandait Colette, pourquoi avez-vous mis sur votre gare des tuiles vertes ? Les vaches des paysans ont envie d’y brouter.
– Et l’Esplanade, disait la mère. C’est malheureux d’avoir dépensé tant d’argent pour la gâter. Des fontaines où l’on voit des grenouilles, debout sur leurs pattes de derrière, qui dansent en buvant des chopes ! Passe encore dans une brasserie, mais sur un monument public ! Cela manque de dignité. Et l’écusson de
Ces dames répétaient là des plaisanteries qu’elles avaient lues dans leur journal, car les vieux Messins ne tarissent pas sur le style néo-schwob. Mais sous ces arguments empruntés, il y avait toute leur sensibilité. Espacées de cinquante ans sur une même tradition, la grand'mère et la petite-fille résonnaient des mêmes chocs. Ce qu’elles sentaient très bien, et ne savaient pas dire, c’était à peu près ceci: « Vous anéantissez des aspects qui sont liés à toutes nos vénérations. Vous coupez les arbres et comblez les puits de notre
Madame Baudoche aimait l’ancien Metz, les vieux remparts, leurs fossés remplis d’eau de
Peut-être que Colette aurait d’elle-même jugé que c’étaient des histoires ressassées, des ravottes, dirait-on là-bas ; mais elle les entendait avec plaisir, en voyant qu’elles faisaient admirer sa mère par cet étranger. M. Asmus écoutait, bouche bée, comme il aurait suivi le cours de quelque maître autorisé. Il entrevoyait une civilisation nouvelle pour lui, et toute fière. Il aurait volontiers prolongé, dans la nuit une conversation si instructive. Mais entre dix heures moins cinq et dix heures précises, la petite cloche d’argent, qu’on nomme Mademoiselle de Turmel, sonnait le couvre-feu à la cathédrale, et Madame Baudoche se levait. Les deux femmes souhaitaient bonne nuit au locataire et se retiraient dans leur chambre.
Au dehors, il pleuvait, neigeait, et les fouettées brutales du vent lorrain, un vent guerrier auquel rien ne résiste, battaient les rues étroites, souvent salies d’un noir dégel. Mais la pluie, le vent, la boue aident l’imagination à ramener sur un paysage et sur un édifice le temps jadis.
Le professeur s’en allait voir méthodiquement, de-ci de-là, dans
Au milieu de ces courses, il rencontrait à tout moment les innombrables wagonnets aux essieux criards qui transportent les décombres des vieux remparts, jetés bas à coups de mines. Il en recevait une vague inquiétude. Il entrevoyait confusément qu’à
Madame Baudoche se prêtait avec complaisance à cette curiosité. Parfois, cependant, les paroles de l’Allemand venaient effleurer ce qu’il n’est pas permis aux étrangers de connaître… Alors elle se taisait. La vieille Messine avait vu les malheurs du siège et les convulsions de la journée du 20 octobre 1870, où fut affichée la proclamation de Bazaine à l’armée du Rhin, tandis que les régiments signaient des protestations pour demander à se battre, et que des bandes d’ouvriers et de bourgeois parcouraient les rues avec des drapeaux, sous le tocsin de tous les clochers. Mais de cela on ne parle jamais avec un homme d’Outre-Rhin, pas plus qu’en dehors d’une famille on ne raconte comment le père a rendu l’âme.
D’ailleurs, ces dames ne vivaient pas exclusivement, comme leur locataire, dans le royaume des méditations historiques. Il arrivait souvent que les petits Krauss descendaient pour attendre leur mère. Colette se livrait avec eux à une sorte de blague, à la fois douce et un peu sèche, comme pour former des enfants de troupe. Puis Madame Krauss arrivait, et la conversation, se détachant plus encore de M. Asmus, semblait délestée, délivrée, et courait à travers les rues de la ville. Ces dames passaient en revue tout leur petit monde messin, et, oublieuses du professeur, qui se taisait, elles ne respectaient pas toujours sa délicatesse nationale.
Madame Krauss avait une verve naturelle excitée et un peu aigrie par les déboires de son mariage avec un Allemand. Celui-ci portait à la brasserie tous ses salaires ; elle y suppléait en aidant au ménage chez un conseiller intime. Et, sur le luxe apparent de ce ménage étranger, elle rapportait régulièrement mille quolibets, anecdotes et mépris qui faisaient la joie du quartier.
Monsieur le Conseiller avait un fumoir et un cabinet de travail ; Madame
– Quelles mœurs ! disaient les trois femmes devant M. Asmus accablé.
Et Madame Baudoche se chargeait de tirer la moralité pour tous, en disant qu’on en avait connu de vrais riches avant la guerre !
Madame Krauss remontée chez elle, et l’atmosphère plus apaisée, le professeur convenait de l’orgueil des fonctionnaires et disait :
– Ils ont la mauvaise habitude de tout dépenser pour la façade, ils se corrigeront.
Et puis il ne fallait pas juger le peuple allemand sur une poignée de parvenus, sortis de leur milieu naturel. A
– Avant la guerre, Monsieur le professeur, nous comptions deux cents millionnaires et qui n’avaient pas de morgue. Quand les gens de mon âge seront partis, on ne saura plus ce qu’il y avait ici de fortune et de bienveillance.
Et c’était un spectacle de voir Madame Baudoche et Colette s’enorgueillir des deux cents millionnaires dont elles n’étaient pas, et l’Allemand considérer avec admiration la vieille opulence de cette noble cité, où le riche était discret.
Ainsi Frédéric Asmus commençait de sentir la grande dignité de la ville de
Par une sorte de riposte instinctive et pour donner une haute idée de ses compatriotes, M. Asmus, à certains soirs, tirait de sa poche une lettre de sa fiancée, dont il lisait les plus beaux passages, généralement philosophiques.
– Comme elle est instruite ! disait Colette.
Il offrit à la jeune fille de lui prêter des livres.
– Je ne
Il proposa d’emprunter des ouvrages français à son collège, où l’on avait tous nos grands classiques.
Mais Madame Baudoche, pleine de pitié pour cet Allemand qui voulait apprendre quelque chose de français à des Messines, alla chercher dans une armoire à glace plusieurs années de l’Austrasie, la vieille revue qui, pendant près d’un siècle, groupa l’élite de la province, et dont il n’est pas de famille qui ne possède quelques numéros.
– On peut apprendre là dedans, dit-elle, tout ce qu’il y a de beau dans tous les pays.
On y voit du moins un élégant miroir de la société polie à
Произведения
Критика