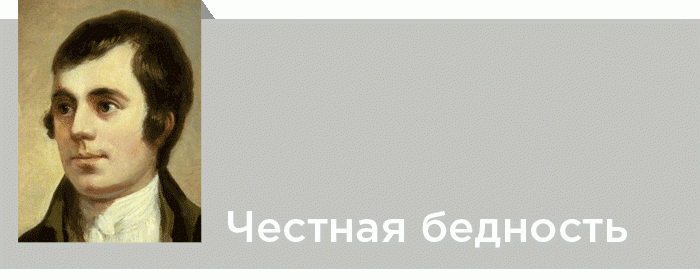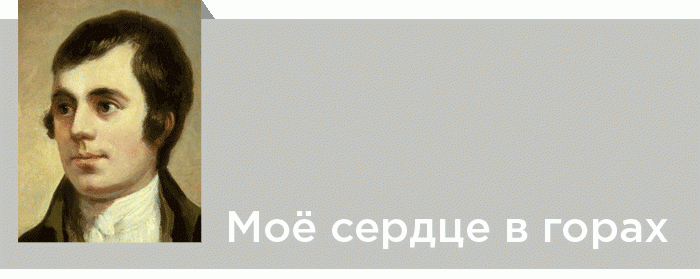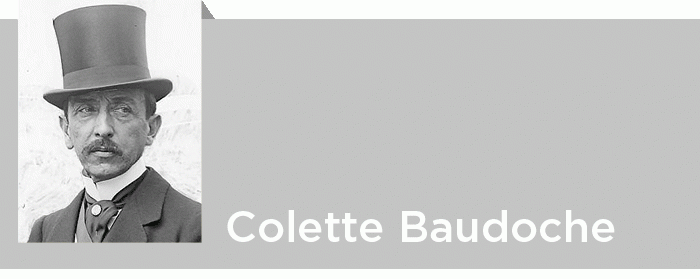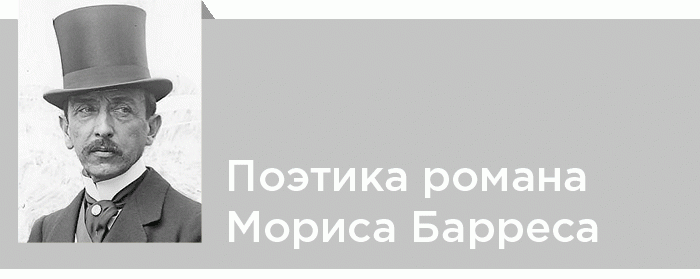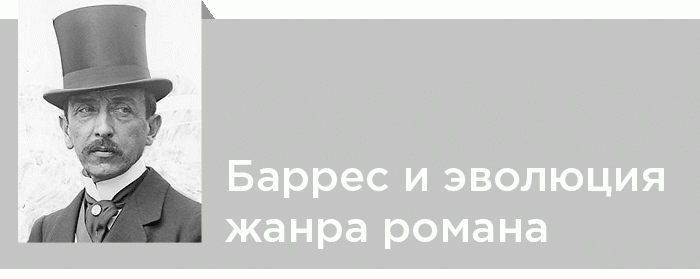Морис Баррес. Беспочвенные

(Отрывок)
CHAPITRE PREMIER
LE LYCÉE DE
En octobre 1879, à la rentrée, la classe de philosophie du lycée de
À des jeunes gens qui jusqu’alors remâchaient des rudiments quelconques, on venait de donner le plus vigoureux des stimulants : des idées de leur époque ! Non pas des idées qui aient été belles, neuves et éloquentes dans les collèges avant la Révolution, mais ces mêmes idées qui circulent dans notre société, dans nos coteries, dans la rue, et qui font des héros, des fous, des criminels, parmi nos contemporains. Et peut-être, à l’usage, perdront-elles leur puissance sur des âmes diverties par les années ; mais en octobre 1879, voici seulement que naissent ces lents enfants de provinces : jusqu’alors, ils n’ont connu ni la vie ni la mort, mais un état où la rèverie sur le moi n’existe pas encore et qui est une mort animée, comme aux bras de la nourrice.
Pour bien comprendre ce qui se passa dans cette année scolaire 1879-1880, où sortirent de la vie végétative et se formèrent dans une crise quelques-unes des énergies de notre temps, il faut se représenter le lycée, réunion d’enfants favorable, comme tout groupement, aux épidémies morales et soumise, en outre, a une action très définie qui marque jusqu’au cimetière la grande majorité des bacheliers.
Le lycéen reçoit de la collectivité où il figure un ensemble de défauts et de qualités, une conception particulière de l’homme idéal. Cet enfant qui plie sa vie selon la discipline et d’après les roulements du tambour, ne connaissant jamais une minute de solitude ni d’affection sans méfiance, ne songe même pas à tenir comme un élément, dans aucune des raisons qui le déterminent à agir, son contentement intime. Il se préoccupe uniquement de donner aux autres une opinion avantageuse de lui. C’est bon à un jeune garçon élève à la campagne de sentir vers dix-sept ans la beauté de la nature et les délicatesses du sens moral ! Toujours pressés les uns contre les autres, inquiets sans trêve de sembler ridicules, les lycéens développent monstrueusement, à ce régime et sous le système pédagogique des places, une seule chose, leur vanité. Ils se préparent une capacité d’être humiliés et envieux qu’on ne rencontre dans aucun pays, en même temps qu’ils deviennent capables de tout supporter pour une distinction.
La qualité qui fait compensation, c’est le sens de la camaraderie. On dit « chic type », dans leur argot, celui qui possède une supériorité, — qu’il versifie ou qu’il ait réussi au Concours général, — et qui, de plus, est bon camarade. Mais être bon camarade, c’est tout d’abord se refuser à la discipline. Il est difficile de ne point la haïr. Ceux mêmes qui l’appliquent en rougissent. Le proviseur, le censeur,
Sur toute la
Quelle conception auraient-ils de l’humanité ? Ils perdent de vue leurs concitoyens et tout leur cousinage ; ils se déshabituent de trouver chez leurs père et mère cette infaillibilité ou même ce secours qui maintiendrait la puissance et l’agrément du lien filial. Les femmes ne sont pas à leurs yeux des êtres d’une vie complète, mais seulement un sexe. En leur présence, ils sont incapables de penser à rien autre qu’à des séductions où excellaient les jeunes Français du siècle dernier et dont leur réclusion, qui les fait timides et gauches, les rend
Isolés de leurs groupes de naissance et dressés seulement à concourir entre eux, des adolescents prennent de la vie, de ses conditions et de son but la plus pitoyable intelligence. On disait couramment au lycée de
Tel est, brièvement décrit, l’esprit de l’internat, auquel les externes eux-mêmes résistent mal, car chacun d’eux se formant sous des influences familiales très diverses, ils ne peuvent opposer une force d’ensemble aux notions habituelles et indiscutées qui composent, dès le seuil, l’atmosphère des grands, des moyens et des petits.
M. Paul Bouteiller, lors de la première classe, prit place dans la chaire et examina un livre jusqu’à ce qu’il jugeât écoulé le délai suffisant pour l’installation de chacun ; alors, il leva les paupières. Un silence parfait s’établit. Dès le premier instant, il n’y eut point de doute que ce jeune maître était de ceux qui dominent une situation.
Il avait ce teint d’un seul ton, cette face décolorée fréquente chez les personnes qui vivent renfermées. Souvent, ses yeux étaient fatigués et légèrement rougis par un travail tard prolongé. La méditation et les soins intellectuels mettent de la gravité sur la physionomie. Son regard n’était jamais distrait ni vague, mais le plus souvent baissé ; sinon, il regardait en face, et de telle façon qu’il n’eut jamais besoin de punir. Il avait du prestige et sut faire appel au sentiment de l’honneur. Il parla. Il leur dit sa haute notion de sa responsabilité, étant venu pour faire des hommes et des citoyens. Mais eux aussi, ils avaient des devoirs, de patriotisme et de solidarité. Quelques-uns prenaient des notes, il les invita à n’en rien faire :
— Ce ne sont pas les matières du cours ; on ne vous interrogera pas là-dessus à l’examen, mais plus qu’un diplôme, ceci est nécessaire : que vous réfléchissiez sur les liens qui nous unissent, afin que vous ayez une conscience plus nette de votre dignité…
À ce mot, un élève, Alfred Renaudin, se mit à rire : il ne lui était jamais venu à l’esprit que lui, lycéen, pût avoir une dignité.
Le professeur immédiatement se tut. Si superbe de raison inflexible apparut sa physionomie que la classe n’osa même point se tourner vers le coupable. Après un long silence :
— Messieurs, dit-il, je n’appliquerai jamais de punitions ; je les juge indignes du maître et des élèves ; mais ceux qui troublent l’ordre auquel nous avons tous droit quitteront la salle. Que l’inconvenant sorte !
Renaudin eut contre lui, disgrâce jusque-là inouïe, le sentiment de ses camarades.
Dorénavant, Racadot et Mouchefrin, qui étaient voisins et se plaisaient, ne polissonnèrent plus que durant les classes d’histoire et de géographie, de sciences et de langues vivantes.
À la fin de cette première semaine, ce fut un autre événement non moins significatif. Le proviseur, accompagné du censeur, se présentait chaque samedi pour lire les notes. De taille moyenne, bien pris dans sa redingote boutonnée, la physionomie impassible et si noble, M. Paul Bouteiller se tint un peu à l’écart. On observa qu’il affectait de ne pas regarder ces dignitaires administratifs. Il les dédaignait. Par là, il enthousiasma ces enfants révoltés.
Il leur parut un frère aîné et tout-puissant. Cette attitude l’égalait au professeur de mathématiques spéciales qui, un jour, d’un coup de pied, avait violemment fermé
— Un proviseur ! eh bien quoi ? c’est un policier !
Après cela, M. Bouteiller peut bien leur enseigner tout ce qu’il voudra sur le respect des lois, sur la discipline sociale. Il a méprisé, au nom de sa supériorité individuelle, un supérieur hiérarchique.
Cependant proviseur et censeur se consultaient :
— Ses allures confirment mes renseignements. Il a des protections.
— Qui donc ?
— Peut-être Gambetta ! dit le proviseur à voix basse.
Devant ces pauvres enfants, vulgaires, cyniques, habitués à craindre des maîtres que les plus développés s’élevaient seulement jusqu’à mépriser, M. Bouteiller tint l’emploi d’un jeune dieu de l’Intelligence. De leurs ardeurs inutilisées, il reçut un prodigieux éclat. Certes, Maurice Rœmerspacher, Henri Gallant de Saint-Phlin, François Sturel, Georges Suret-Lefort, Alfred Rénaudin, Honoré Racadot, Antoine Mouchefrin, tout ce petit troupeau, en marche pour la vie et encore indiscernable, paraîtrait arriéré à des « philosophes » de Paris. Bien qu’en eux une force d’hommes soit prête à éclater, ils demeurent, par le geste et le vocabulaire, des enfants. La formation n’est pas hâtive en province, mais peut-être ces jeunes gens, qui profitent d’une longue hérédité campagnarde et dont nul bruit de la vie ne détourne l’enthousiasme, ont-ils une naïveté plus avide, plus réceptive, que les merveilleux adolescents parisiens, un peu débiles et déjà de curiosité dispersée par leurs plaisirs du dimanche.
Jeunes sauvages, serrés sur leurs bancs, ils l’écoutent, l’observent, un peu méfiants, le guettent et s’apprivoisent par l’admiration. Ils allèrent jusqu’à s’émerveiller qu’il fût d’une propreté parfaite. En eux apparaissaient les éléments de poésie de la puberté, certaines délicatesses qui se perdaient en minuties pour n’avoir pas encore trouvé leur direction. Ce jeune homme au teint mat, qui avait quelque chose d’un peu théâtral, ou tout au moins de volontaire dans sa gravité constante et dans son port de tête, fut confusément l’initiateur de ces gauches adolescents. La jeunesse est singe : on cessa de se parfumer au lycée de Nancy, parce que Paul Bouteiller, qui n’avait pas le goût petit, séduisait naturellement.
Ils l’associaient à toutes les notions qu’ils s’étaient amassées du sublime moderne. Dans un âge où les lycéens du premier Empire entendaient le canon de Marengo et parfois le coupé de l’Homme traversant en hâte leur ville, ces enfants, grandis depuis la guerre, n’avaient d’autre idée générale de qualité émouvante que la France vaincue et la lutte de la République contre les partis dynastiques. D’instinct, ils symbolisaient et glorifiaient la persistance de la patrie dans le nom national et républicain de Victor Hugo. Les vieux professeurs des petites classes lui déniaient tout talent ; en rhétorique, on admettait certaines de ses beautés modérées. De ces injustices, les lycéens, en 1879, frémissaient. Quinze jours environ après la rentrée, M. Bouteiller leur apporta la seconde série de la Légende des siècles : il lut l’Hymme à la Terre, où l’on jette un magnifique regard sur le fleuve épandu, sur le Gange que fut au terme de sa course le vieux maître, et, le commentant avec sa belle voix grave, pure d’accent provincial et dont l’autorité leur semblait religieuse, il ouvrit à ces êtres encore intacts les grands secrets de la mélancolie poétique.
Quelle matière sublime qu’un troupeau de jeunes mâles reclus, confiants et avides ! Par ses actes, même indifférents, M. Bouteiller les modelait. Sa renommée s’était répandue ; des parents voulurent le connaître. Il découragea ces avances par sa froideur : il voulait qu’on respectât son temps. Aussi fut-on surpris qu’un jour, après la classe, il dît à un externe : « Monsieur votre père ira-t-il au cercle, ce soir ? » Cet élève était fils d’un juif, conseiller municipal de la ville. Cependant, la grandmère d’Henri Gallant de Saint-Phlin, ayant manifesté le désir de l’entretenir, il la pria de passer chez lui et la reçut debout, en manches de chemise, dans une chambre défaite. Cette fois, c’était plus que le désir de s’isoler, et nettement une grossièreté voulue.
Gallant de Saint-Phlin, qui était un enfant admirable de négligence sur soi-même, de vivacité d’esprit et d’absence totale de malice, souffrit de cet échec : sa grand’mère se refusa désormais à partager son enthousiasme pour son professeur, et ses camarades l’humilièrent sur cet incident qu’il était incapable de taire. Il souffrait d’un léger désordre nerveux, qui montait passagèrement au degré de la passion les mouvements successifs de son âme tendre, noble et incertaine. Agité d’un besoin d’épanchements affectueux, il cherchait la popularité, la chaude sympathie de tous. Or, il était différent. Jusqu’à sa rhétorique, il avait travaillé avec un précepteur chez sa grand’mère ; et cette vie de famille, dans une belle propriété à la campagne, lui avait composé une nature telle qu’au lycée, après dix-huit mois d’initiation, il demeurait un nouveau. Il paraissait sans attache avec les réalités : c’est qu’elles n’étaient pas pour lui dans les usages et dans les règles du lycée, mais dans l’amour de sa famille et dans les longues promenades forestières de l’Argonne. Incapable d’observer les distances convenues entre professeur et élèves, il faisait la joie de la classe par ses discours et objections sur les matières du cours. Quand M. Bouteiller, ayant lu l’Hymne à la Terre, dit : « Je suis content de vous, avoir révélé une des pièces les plus profondes du poète philosophe », Gallant de Saint-Phlin lui répondit vivement :
— Je la connaissais ; je l’ai entendue de nouveau avec plaisir, mais c’est une vision astronomique et préhistorique : à la campagne, je comprenais mieux les Géorgiques.
De telles réflexions, où l’on sent l’influence d’un ecclésiastique médiocre et cultivé, mais enfin intéressantes, déplaisaient à M. Bouteiller, parce qu’en troublant de rire la classe, elles déplaçaient les effets, et dérangeaient sa mise en scène. Et puis, il n’aimait pas Gallant de Saint-Phlin.
Ces enfants réunis de tous les points de la Loraine avaient dans toute son âpreté le magnifique sentiment égalitaire du paysan français. Ils découvrirent aussitôt que M. Bouteiller avait pris ce ton avec la grand’mère de leur camarade parce que les Saint-Phlin étaient des ennemis de la République. Le retentissement fut immense, hors de la classe de philosophie, dans tout le lycée subitement informé.
L’Université est un puissant instrument d’État pour former des cerveaux : elle a enseigné le dévouement à l’Empire, aux Bourbons légitimes, à la famille d’Orléans, à Napoléon III ; elle enseigne en 1879-1880 les gloires de la Révolution. À toutes les époques, elle eut pour tâche de décorer l’ordre établi. On peut se croire à dix-sept ans révolté contre ses maîtres ; on n’échappe pas à la vision qu’ils nous proposent des hommes et des circonstances. Notre imagination qu’ils nourrissent s’adapte au système qui les subventionne. Dans les lycées, on est républicain ; dans les établissements religieux, réactionnaire et clérical. Georges Suret-Lefort, qui sortait d’un collège de prêtres, n’aimait pas la République. Sans doute, la supériorité de manières et de fortune de ses camarades bien nés l’avait froissé, mais au milieu des vulgarités du lycée il oubliait leur arrogance — qui chez des enfants de douze ans n’a d’égale que la susceptibilité, — et, fier d’avoir connu mieux, il flétrissait la mauvaise éducation des républicains. Merveilleusement habile à distribuer son temps, il trouvait chaque jour des heures pour feuilleter le Dictionnaire historique de Bouillet, au point de pouvoir réciter les biographies des dignitaires du premier Empire. Les plus fameux révolutionnaires satisfaisaient aussi son romanesque ; hélas ! cette grande espèce, pensait-il, a disparu. Quand il vit un tel homme, dont le prestige le fascinait, servir la République, ses antipathies pour ce système s’évanouirent. En cour, il déclara :
— Le malheur, c’est qu’il n’y en a pas beaucoup comme celui-là.
Ainsi, M. Bouteiller, dès, le début, se confondait pour ses élèves avec les deux images les plus importantes qui flottaient sur la
Dès ses premiers entretiens, quand il leur parlait de Victor Hugo, et parfois même de Gambetta, quand, par l’affront à Madame de Saint-Phlin, il se posait en démocrate orgueilleux de sa qualité peuple, il incarnait pour eux l’esprit national moderne ; mais aujourd’hui que, se promenant de long en large, il dicte son cours, et surtout s’il ordonne qu’ils posent leurs plumes pour mieux suivre tel rapprochement à travers les siècles, c’est vraiment l’Univers qui parle par sa bouche : l’humanité conte ses rêves, le monde révèle ses lois.
Depuis 1870, une caractéristique des jeunes gens, c’est qu’ils "font de médiocre rhétorique et d’excellente philosophie. Pendant quelques années, l’humanité dans un pays montre avec surabondance une aptitude qui disparaîtra presque de la période suivante. Nés pour s’émouvoir des problèmes philosophiques, ces pauvres êtres, entravés sur les bancs de la classe, tandis que la beauté se révélait à eux, — puis, en étude, sous les lampes qui leur chauffaient le crâne, relisant leurs notes, — puis au dortoir, maintenus en veille par une fièvre d’imagination, parmi les souffles réguliers des rhétoriciens et des scientifiques, — connurent ces incomparables exaltations qui deviennent, passé trente ans, le privilège de quelques natures royales.
À la fin de novembre, quand il commença de leur expliquer les vieux penseurs de l’Ionie et qu’il voulut retrouver chez eux les conceptions les plus modernes de la science, quand sa voix grave montra comment la doctrine orientale des épurations et des métempsycoses, enseignée dans les temples et les grandes écoles de la Grèce, est confirmée par les théories modernes qui rattachent la destinée humaine aux métamorphoses de la nature et aux lois de la vie universelle, ces graves problèmes, ce recul au fond des siècles, cette certitude créée par la concordance des religions du passé avec les académies de Paris et de Berlin, enivrèrent ces enfants d’une poésie qui ressemblait à de l’épouvante. Plus de salles d’études pour écoliers, plus de préaux pour camarades, mais d’immenses horizons imprévus et mouvants ! Des phrases se détachaient du cours avec la force d’un thème musical qui leur faisaient sensible la loi des choses, et cette loi variait chaque semaine selon le philosophe de la leçon : ils devenaient éperdus devant la multiplicité, la splendeur et la contradiction des systèmes.
M. Bouteiller se hâta de les fixer. Kantien déterminé, il leur donna la vérité d’après son maître. Le monde n’est qu’une cire à laquelle notre esprit comme un cachet impose son empreinte… Notre esprit perçoit le monde sous les catégories d’espace, de temps, de causalité… Notre esprit dit : « Il y a de l’espace, du temps, des causes » ; c’est le cachet qui se décrit lui-même. Nous ne pouvons pas vérifier si ces catégories correspondent à rien de réel.
En décembre, après une affreuse semaine de brouillards et comme les leçons de cette métaphysique désolée avaient encore été aggravées par les lumières de rouille qui pesaient sur la classe, Maurice Rœmerspacher écrivit aux siens une lettre vraiment douloureuse sur les limites de la connaissance. Elle révélait un tel désarroi qu’un jour, à l’affût au sanglier, son père la lisant à son compagnon de chasse qui haussait les épaules, déclara :
— Si je l’ai fait comme cela, il faut bien que je l’accepte ; mais je crois bien que lui et moi, nous sommes refaits.
Leur état n’avait rien de commun avec les angoisses d’un Jouffroy ou les balancements d’un Renan. La grande affaire pour les générations précédentes fut le passage de l’absolu au relatif ; il s’agit aujourd’hui de passer des certitudes à la négation sans y perdre toute valeur morale. Soudain un homme d’une grande éloquence communiquait à ces jeunes garçons le plus aigu sentiment du néant, d’où l’on ne peut se dégager au cours de la vie qu’en s’interdisant d’y songer et par la multitude des petits soucis d’une action. Dans l’âge où il serait bon d’adopter les raisons d’agir les plus simples et les plus nettes, il leur proposait toutes les antinomies, toutes les insurmontables difficultés reconnues par une longue suite d’esprits infiniment subtils qui, voulant atteindre une certitude, ne découvrirent partout que le cercle de leurs épaisses ténèbres. Ces lointains parfums orientaux de la mort, filtrés par le réseau des penseurs allemands, ne vont-ils pas troubler ces novices ? La dose trop forte pourrait jeter chacun d’eux dans une affirmation désespérée de soi-même ; ils se composeraient une sorte de nihilisme cruel.
M. Bouteiller, après une étape dans le scepticisme absolu, et sitôt les vacances du nouvel an passées, croyait bien avec Kant et par l’appel au cœur reconstituer à ses élèves la catégorie de la moralité et un ensemble de certitudes. Ils ne le suivirent pas.
C’est que la force vive de la puberté s’amassait dans leur sang. Les plus banales mélancolies ont une puissance infinie dans les jeunes poitrines qu’elles emplissent. En vain, le 8 janvier 1880, il se surpassa en dignité et, comme on dit des prédicateurs, en « pectus », pour leur commenter la page sublime : « Deux choses comblent l’âme d’une admiration et d’un respect toujours renaissants, et qui s’accroissent à mesure que la pensée y revient plus souvent et s’y applique davantage : le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale au dedans. » Ce n’est pas la loi morale qu’éveille le ciel étoilé dans la conscience de François Sturel. Au dortoir, couché auprès d’une fenêtre, jusqu’à ce que le sommeil apaisât le tumulte de ses sensations, il s’attachait de toute son âme à la plus brillante des clartés célestes, et, sachant par la biographie de Napoléon que les ambitieux ont leur étoile, et aussi les amoureux, et aussi les grands poètes, il pleurait par crainte de vivre sans génie, et cherchait à surprendre aux constellations les secrets de gloire et d’amour. Ce qu’il adressait aux profondeurs du ciel, c’était le cri des jeunes âmes exaltées : « Trouverai-je mon objet dans la vie ? » Mais il le formulait ainsi : « Égalerai-je jamais en génie Bouteiller ? »
Au matin, avec ses beaux yeux largement, cernés par l’ardeur de ses rêves, il était plaisanté par ses pauvres camarades qui, tous, du lycée, avaient reçu le ton obscène de la caserne, et lui-même l’adoptait, déjà gâté de grossièreté. Ce milieu, s’il salit tout l’extérieur des adolescents, du moins fortifie la puissance du rêve en le refoulant. Celui qui grandit hors de la société des femmes, appliqué à ne pas différer de compagnons vulgaires et railleurs, n’épanouira jamais sur son visage et dans tous les mouvements de son corps la grâce sublime d’une âme confiante ; mais ses jouissances intimes, qu’il ne pourra partager avec personne, y gagneront en âpreté.
De l’ambition mêlée à la mélancolie romanesque, voilà ce que l’on retrouve au cours de ce siècle, chez des milliers de jeunes gens, les Julien Sorel, les Rubempré, les Amaury, pour qui les conquêtes de la bourgeoisie ont rompu les frontières sociales, et ouvert tous les possibles. M. Bouteiller, qui croit soumettre ses élèves à la notion du devoir, ne fait que les jeter plus ardents dans la voie commune aux jeunes Français modernes. Et leurs lectures aussi les exaltent sans plus leur fournir de sentiment social.
Dans chaque quartier de lycée se trouve une petite bibliothèque, composée d’après l’âge des élèves. L’apprenti philosophe y connaît à travers de faibles contradicteurs les grands esprits libres. Malmenés, parfois injuriés par les éditeurs universitaires, ils se présentent à l’enfant comme des révoltés, des proscrits ; par là son imagination, qu’ils auraient bien su ébranler, est plus fortement séduite. Il les lit sous la flamme du gaz, dans un lieu infecté par tant d’adolescents pressés, dans une atmosphère de contrainte, de malaise, d’irritation et de grossièreté. Son sang en est brûlé ; sous leur poids, son âme prend une pente selon laquelle dorénavant coulera tout ce qu’elle recevra de la vie. Le grand air, les horizons libres, la douceur d’une jeunesse passée dans une harmonie d’intérêts naturels et d’affections, donneraient à de tels livres un sens qu’ils n’ont pas dans les cellules d’un lycée. Et Rousseau, qui fait aimer et donne le sens de la fraternité, si tu le lis dans un verger, les tourmentait de sensualité et de sauvagerie mélancolique, tumultueux petit livre lu secrètement aux lueurs tard prolongées d’un jour de juin, splendide, mais trop lourd pour le prisonnier.
Du professeur ou du livre, nous recueillons seulement ce que notre instinct reconnaît comme sien, et nous interprétons avec une étrange indépendance. Alors que le maître réfute, souvent ses indignations tombent lourdement au pied de sa chaire, et la doctrine qu’il pense avoir détruite, il l’a propulsée dans des êtres avides qui, dès lors, en seront animés. Les mouvements si violents de ces jeunes âmes ne se traduisent pas encore en actions. M. Bouteiller, qui leur parle, avec une insistance éloquente, de cette idée supérieure du devoir qui gît dans chaque conscience et qui prouve l’existence de Dieu, jamais ne se penche pour écouter leurs murmures intérieurs. Nul doute qu’il eût été stupéfait de constater les prolongements de sa parole dans ces jeunes cerveaux. Mais voilà un des aspects les plus intéressants de l’œuvre de M. Bouteiller au lycée de Nancy : il fait avec ampleur son geste de semeur et ignore absolument ce que devient la graine.
Pour qu’il prévît sa moisson, il eût fallu qu’il connût son terrain ; c’est une étude qu’il dédaigne. Ce kantien ne se rend pas compte que d’être parvenu à son degré élevé de culture, d’avoir échappé à la patrie restreinte et à ses intérêts étroits pour appartenir à la France, à l’humanité tout entière et à la raison, c’est une puissance qui, chez un éducateur, implique un devoir : le devoir et la puissance de comprendre toutes les conditions de l’existence, qui sont diverses suivant les milieux. Chaque individu est constitué par des réalités qu’il n’y a pas à contredire ; le maître qui les envisage doit proportionner et distribuer la vérité de façon que chacun emporte sa vérité propre.
Et même avant d’examiner les biographies de ses élèves, M. Bouteiller ne devrait-il pas prendre souci du caractère général lorrain ? Il risque de leur présenter une nourriture peu assimilable. Ne distingue-t-il pas des besoins à prévenir, des mœurs à tolérer, des qualités ou des défauts à utiliser ? Il n’y a pas d’idées innées, toutefois des particularités insaisissables de leur structure décident ces jeunes Lorrains à élaborer des jugements et des raisonnements d’une qualité particulière. En ménageant ces tendances naturelles, comme on ajouterait à la spontanéité, et à la variété de l’énergie nationale ! C’est ce que nie M. Bouteiller. Quoi ! à la façon d’un masseur qui traite les muscles de son client d’après le tempérament qu’il lui voit, le professeur devrait approprier son enseignement à ces natures de Lorrains et aux diversités qu’elles présentent ! C’est un système que M. Bouteiller n’examine même pas.
Déraciner ces enfants, les détacher du sol et du groupe social ou tout les relie pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite, comment cela le gênerait-il, lui qui n’a pas de sol, ni de société, ni, pense-t-il, de préjugés ?
Fils d’un ouvrier de
M. Bouteiller sait qu’un individu n’a pas de droits contre la société et il connaît ce qui convient le mieux à la société. En conséquence, il lui appartient de la servir en l’administrant, comme à ce troupeau d’enfants de la servir en se pliant à une sage administration. Il ressemble en plusieurs points essentiels — bien qu’il s’en distingue par ailleurs, fortement — à M. Burdeau. M. Burdeau a écrit : « Nous n’avons le droit de distraire du service de l’État aucune fraction de notre fortune, aucun effort de notre bras, aucune pensée de notre intelligence, aucune goutte de notre sang, aucun battement de notre cœur. » Désireux d’utiliser son passage à
Au résumé, il serait absurde de supposer qu’un Bouteiller, qui a pris sur Kant son point d’appui et qui désormais, ne le vérifie pas plus que ne fait un croyant pour la vérité révélée, qui est le délégué parfait d’une espèce psychologique et d’un parti social, peut s’attarder à peser les conséquences de son enseignement et les risques d’égarer les caractères d’une douzaine de jeunes gens. Il tient son rôle strictement, comme une consigne reçue de l’État. C’est le sergent instructeur qui communique à des recrues la théorie réglée en haut lieu. Exactement il leur distribue de vieux cahiers, rédigés depuis huit ans et qu’il a dictés à Nice, à
Pendant que ces vieux cahiers, présentés avec chaleur, tombent en nouveautés enivrantes sur des êtres avides de recevoir, il assouplit sa voix, essaie des débuts à voix basse qui forcent un public à l’attention, cherche et trouve ces intonations émouvantes, ces accents du devoir et ces appels à l’énergie virile qui s’accordent le mieux avec son génie.
M. Bouteiller forme sa domination en déformant des âmes
Ses menées étaient secrètes ; il ne s’en expliquait pas au préfet, et pas davantage à la loge. Il fit chasser le portier du lycée, un nommé Fanfournot, type singulier, bonapartiste enragé, qui amusait beaucoup, et ne scandalisait guère. En vain, des professeurs apitoyés essayèrent-ils d’éviter une telle rigueur au vieux soldat, qu’ils présentaient comme une sorte d’imbécile sympathique. Rien n’y fît et, sur un ordre, le portier dut décamper avec son fils de douze ans, Louis Fanfournot, qui, par la même catastrophe, perdit sa bourse. C’était un enfant très doux, très nerveux, et dans la cour des petits on eut les larmes aux yeux, en le reconduisant à la grille, un dur soir d’hiver. M. Bouteiller fut soupçonné : ses collègues, entre eux, le blâmaient ; tous ses élèves nièrent sa responsabilité ou reconnurent son austère sentiment du devoir, des implacables exigences du devoir.
Ce rôle de dénonciateur n’inquiétait pas sa conscience : elle se fiait tout entière à une règle morale acquise dans des méditations de cabinet et qu’elle ne remettait jamais en discussion. Quand M. Bouteiller était encore élève, un de ses condisciples déroba une montre, fut convaincu, puis, sur ses pleurs et ses supplications, pardonné par le volé ; mais lui, solennellement, porta plainte au proviseur, exigea l’expulsion du coupable.
Avec quiétude, il faisait reposer toute sa conduite comme son enseignement sur le principe kantien qu’il formulait ainsi : « Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle. » — Dans les cas particuliers que nous citons, il avait jugé qu’il n’appartient pas à un brouillon qui se pique de générosité de maintenir quelque chose de pourri dans une collectivité.
Il y a dans cette règle morale un élément de stoïcisme, et aussi un élément de grand orgueil, — car elle équivaut à dire que l’on peut connaître la règle applicable à tous les hommes, — et puis encore un germe d’intolérance fanatique, — car concevoir une règle commune à tous les hommes, c’est être fort tenté de les y asservir pour leur bien ;
— enfin il y a une méconnaissance totale des droits de l’individu, de tout ce que la vie comporte de varié, de peu analogue, de spontané dans mille directions diverses.
Cette dure morale sert M. Bouteiller. Par ces manœuvres, il donne des gages à ses grands amis de Paris ; — je doute que ce fût un calcul, ces natures abstraites étant, par définition, dégagées des mesquineries ; — mais les partis, s’ils aiment qu’on les serve, apprécient surtout qu’on se coupe toute retraite vers leurs adversaires. Par la puissance et par la discrétion de son travail, — en toute carrière, n’est-il pas légitime qu’un débutant se laisse exploiter ? — et surtout par son zèle sectaire, il mérita l’estime de Gambetta, qui sans trêve recrutait des hommes. Un jour de mai, le jeune professeur monta dans sa chaire plus blême, plus grave, plus homme de conscience que jamais et, après un long silence, ayant levé les yeux sur les élèves qu’émouvait un pressentiment :
— Messieurs, leur dit-il, je viens de traverser une des crises de conscience les plus pénibles qu’il m’ait été donné de subir, moi, qui, je puis le dire, en ai subi de si douloureuses dans l’année 1871 où le devoir s’obscurcissait en même temps que la notion de patrie et l’idée d’humanité. Cette nuit, j’avais à choisir entre deux devoirs. Le gouvernement de la République m’appelle dans un lycée de Paris. Dois-je accepter ? Dois-je quitter des intelligences auxquelles je me suis attaché, auxquelles je puis encore être utile ?
« Je n’ai pas besoin de vous dire que l’idée d’avancement n’a pu un seul instant plaider dans ce débat intérieur. À celui qui depuis des mois est le compagnon de votre pensée, vous ferez bien l’honneur d’accorder qu’il n’envie d’autre poste que celui où il peut rendre son maximum de services.
« Mais, précisément, dans l’espèce, suis-je juge de mon utilité ?
« Si le gouvernement de la République dispose de ce que j’ai de forces, ne dois-je pas m’incliner ? Les considérants que j’apporterais dans cette discussion ne seraient-ils pas, à mon insu, l’expression du plaisir que je trouve parmi vous ? Oui, nous avons fait le plus pénible de notre tâche. Nous sommes des caractères qui avons appris à nous connaître. Il ne nous restait plus qu’à jouir de l’atmosphère fortifiante des sommets. Dans le début, nous nous étions un peu attardés aux philosophes d’Ionie ; et l’on coupe court difficilement, je l’avoue, aux entretiens de Socrate. L’hellénisme examiné, nous allions presser le pas, traverser plus rapidement des cultures notables, mais qui n’intéressent pas votre vie. C’est alors que nous aurions embrassé une grande pensée, la plus ample la plus décisive, dont, à plusieurs reprises, je vous ai signalé les temps : comment Kant aboutit au scepticisme absolu et puis comment il rétablit le principe de certitude, disant : « Une réalité existe, c’est la Loi morale. » Beaux horizons, messieurs, qu’il ne nous est pas donné de parcourir ensemble, mais, prévenus par mes soins, vous voudrez souvent y revenir.
« Cette certitude des satisfactions que je trouverais à rester au milieu de vous me rend suspect le désir que j’en ai. Le devoir, pour l’ordinaire, a des aspects plus austères. Craignons de nous masquer la vérité par égoïsme.
« N’y a-t-il pas ailleurs une tâche plus lourde ? des esprits qui ont besoin d’un conseiller, d’un guide ? Je remets leur sort entre vos mains. Pour moi, j’ai fait mon sacrifice. Si je n’ai pu cette nuit prendre un instant de repos, c’est que je devais accepter cette douloureuse séparation. À vous maintenant d’apprécier si vous vous sentez l’énergie d’immoler au meilleur bien l’avantage incontestable de continuer sous un même maître la préparation de votre examen.
« Nous allons voter. Voter librement ; je me conformerai à la décision de votre majorité, mais l’on aura vu si vous êtes des hommes capables de céder au devoir.
« Que ceux qui sont décidés à s’incliner devant la décision du gouvernement lèvent la main. »
Après s’être regardés les uns les autres, ils mirent les mains en l’air. M. Paul Bouteiller dit :
— Maintenant l’épreuve contraire. Que ceux qui protestent contre mon départ lèvent la main.
Gallant de Saint-Phlin seul leva la main. Quelques-uns, soit par servilité, soit sous l’action du speech de M. Bouteiller, le huèrent. Mais le maître les fit taire.
— Monsieur Gallant de Saint-Phlin a usé de son droit absolu. Je lui demanderai seulement de nous dire, s’il le veut bien, le motif de sa protestation, qui, je le constate, est unique.
Gallant, debout, comme c’était la coutume pour réciter la leçon et, très intimidé, sa petite figure jaune et pâle un peu animée de rouge, dit :
— J’ai pensé que l’on pourrait envoyer à
L’argument, quoique présenté sans aplomb, portait avec lui une telle évidence que chacun en eût été gêné, sans M. Bouteiller qui répondit de sa belle voix grave :
— Je suis touché du regret que vous exprimez de mon départ, monsieur Gallant de Saint-Phlin, mais, croyez-moi, c’est nous qui avons raison, et contre un devoir il ne faut pas subtiliser ; il ne faut jamais non plus que nos préférences personnelles interviennent contre ce qui porte un caractère d’utilité générale. Rappelez-vous le principe sur lequel nous fondons toute morale. Combien de fois nous l’avons formulé ! C’est d’agir toujours de telle manière que notre action puisse servir de règle. Il faut se conformer aux lois de son pays et aux volontés de ses supérieurs hiérarchiques. J’irai donc à
Alors cet homme admirable descendit de sa chaire, et, se promenant le long des bancs, commença de dire une façon de bonne aventure à chacun de ces enfants, tremblants de gêne et d’orgueil. C’était exactement le sorcier de jadis, mais d’aspect moderne. Il disposait des mêmes forces, — autorité dans le regard, intonation prophétique, et psychologie pénétrante. — L’âme un peu basse de cet homme, qui leur faisait l’illusion d’un philosophe et qui n’était qu’un administrateur, se trahissait en ceci qu’il les avertissait sur leur emploi et non sur leur être. Il voyait partout des instruments à utiliser, jamais des individus à développer.
— Monsieur Rœmerspacher, il faut que vous entriez à l’École normale. Vous avez de la puissance de travail, peu de faculté imaginative, un grand bon sens, de la santé intellectuelle. Voilà ce qui convient dans notre Université à une époque où il s’agit d’unifier les caractères.
« A vous aussi, monsieur Sturel, on pourrait conseiller l’École normale : vous deviendriez un de ces esprits distingués, agiles et fins comme il s’en forma autour de Weiss, d’About, d’Assollant. Mais la tâche pressante, la tâche si grave des éducateurs modernes, former une génération républicaine ! selon moi ne veut pas de brillant : c’est un luxe de vainqueurs… En revanche, vous ferez un excellent magistrat. Il existe chez ces messieurs une tradition de culture agréable que la République aurait tort de laisser perdre : le magistrat, désigné comme le soldat pour servir l’organisation sociale sans la juger, a droit à distraire son esprit. Vous avez de la fortune, je crois ; avec votre éducation, votre parfaite honorabilité de famille, vous ferez un excellent magistrat, et si, comme il est probable, vous avez quelque don de parole, vous fournirez aisément une belle et utile carrière.
« Vous, monsieur Gallant de Saint-Phlin, — toute la classe tomba en arrêt, prête à rire, — vous devriez entrer à Saint-Cyr.
Gallant de Saint-Phlin répondit avec naïveté :
— Ma grand’mère ne veut pas.
M. Bouteiller sourit ; il fit un geste qui signifiait : « Oh ! vous m’en direz tant, petit garçon !… » Et sur tous les bancs les élèves se balançaient de joie. Bouteiller les calma.
— Dès lors, monsieur Gallant de Saint-Phlin, ce que vous avez de mieux à faire s’indique, c’est de soigner vos propriétés. Il faudra venir de temps en temps à
Bouteiller ne s’arrête pas un instant à comprendre la réponse de Saint-Phlin. Cet enfant, fils d’un général et orphelin de mère, fut élevé par sa grand’mère dans une propriété qu’elle gère elle-même et qui représente tout leur patrimoine. Elle juge sainement qu’il pourrait y mener une vie honorable et utile. Les intérêts réels de l’enfant et de ce coin de France, canton de Varennes, ont été étudiés de plus près par cette vieille dame que par un philosophe nomade. Celui-ci, qui ne s’attache qu’à trouver des serviteurs à l’État, méprise un petit être accroché à sa famille. C’est par un simple mouvement de justice qu’il ne veut pas le quitter en le bafouant et qu’il conclut :
— Ne riez pas, messieurs, Gallant de Saint-Phlin est un bon Français. Le pays le trouverait aux jours graves !
Puis, passant au voisin :
— Vous avez de la ténacité, monsieur Racadot, et de la discipline. Si votre esprit d’une croissance plus vigoureuse que rapide ne vous permet pas d’atteindre l’École normale dans les délais, pourquoi ne chercheriez-vous pas l’agrégation de grammaire ? Mais à quelque administration que vous apportiez votre concours, vous ferez un excellent fonctionnaire, solide au poste, utile à ses chefs et désigné pour de justes distinctions.
Enfin, il s’arrêta devant Suret-Lefort dont il estimait le sérieux.
— Monsieur Suret-Lefort, je vous vois au barreau. J’ai lieu d’espérer que vous ne vous perdrez pas dans des chicanes d’intérêts privés, — cependant respectables… S’il arrivait qu’à votre heure, mûri par votre expérience et par la confiance de vos concitoyens, vous dussiez intervenir dans les grands débats d’un peuple libre, je compte que vous donneriez votre concours aux doctrines sociales qui font l’essentiel de la philosophie telle que l’entend celui qui avait accepté la charge de vous enseigner, au nom du gouvernement, la loi morale et ses effets sur l’activité humaine.
Ainsi parlait-il à chacun. Eux le regardaient marcher, jouissaient de sa voix, contemplaient son autorité, plus avidement qu’ils n’eussent écouté un héros de tragédie… « Il va à
En suivant les bancs, M. Bouteiller avait rencontré les boursiers : Renaudin, Mouchefrin… Il sentit probablement à prophétiser l’avenir de ceux-là des difficultés. Entre les études universitaires et les emplois rémunérateurs, il y a une fosse qu’un pauvre est à peu près impuissant à franchir. Il différa de traiter leur cas jusqu’à ce qu’il eût fini avec les autres… Et regagnant sa chaire :
— Messieurs, peut-être en est-il parmi vous que j’ai méconnus : je les prie de m’excuser. Ils ne doivent pas en souffrir, mais considérer que seul vaut le jugement de notre conscience. Mes dernières paroles, je veux les offrir à ceux de vos camarades qui, moins favorisés par la naissance, sont redevables de leur instruction à l’initiative de la société. Elle n’a fait qu’obéir à la justice : l’héritage amassé par l’humanité pensante n’est point le privilège de la fortune ; sur ce fond social, chacun possède un droit égal et complet ; mais la situation de ceux qui en profitent leur commande un dévouement particulier à la République… Messieurs Renaudin et Mouchefrin, ne soyez pas effrayés par la vie. Rien n’est interdit à l’honnêteté et à la persévérance. Je me glorifie, si modeste que soit mon rôle, d’avoir été appelé à le tenir après avoir été moi-même un boursier. Ce m’est une raison pour m’intéresser spécialement à vous deux. Ne pouvant pas serrer la main de tous vos camarades, c’est à vous, Messieurs, que je veux donner, dans ce dernier et pénible moment, une cordiale poignée de main.
Vit-il une déception ? Comprit-il qu’il leur apparaissait comme le vainqueur du monde et leur offrait peu ? Agitant son chapeau et serrant sa serviette sous le bras, toute la classe debout, il fit à ces enfants une chaude allocution sur sa confiance qu’ils se conduiraient toujours en serviteurs de l’État et en braves Français.
Ah ! oui ! c’étaient bien des Français, ces adolescents excitables ! Il suffit de les voir, avec leurs doigts tachés d’encre, leurs humbles vêtements de travail, leurs mentons à poils mal soignés, tout émus, électrisés par l’éloquence aimée et par la grande autorité du jeune maître :
— Vive la France ! Vive la République ! crient-ils d’une voix unanime.
La France ! la République ! Ah ! comme ils crient !… Il ne sert de rien qu’on prêche l’État, la France, la République. C’est du verbalisme administratif. Mais précisément, un bon administrateur cherche à attacher l’animal au rocher qui lui convient ; il lui propose d’abord une raison suffisante de demeurer dans sa tradition et dans son milieu ; il le met ensuite, s’il y a lieu, dans une telle situation qu’il ait plaisir à s’agréger dans un groupe et que son intérêt propre se soumette à la collectivité. On élève les jeunes Français comme s’ils devaient un jour se passer de la patrie. On craint qu’elle leur soit indispensable. Tout jeunes, on brise leurs attaches locales ; M. Bouteiller n’a pas su dire à ses élèves : « Prenez votre rang dans les séries nationales. Quelques-uns d’entre vous pour être plus sûrs de leur direction, ne veulent-ils pas mettre leurs pas dans les pas de leurs morts ?… Vous, Suret-Lefort et Gallant de Saint-Phlin, faites attention que le Barrois décline ; Bar a cessé d’être une capitale, mais il vous appartient d’en faire une cité où vous jouerez un noble rôle… Avez-vous remarqué, Mouchefrin, comment l’initiative d’un seul homme, M. Lorin, a transformé en magnifique bassin minier la région de Longwy ?… Rœmerspacher, on dit que les Salines de la Seille sont en décadence. »
Le Barrois, le pays de la Seille, la région de Longwy, les Vosges, donnent à la Lorraine des caractères particuliers qu’il ne faut pas craindre d’exagérer, loin que cette province se doive effacer. Mais l’université méprise ou ignore les réalités les plus aisément tangibles de la vie française. Ses élèves grandis dans une clôture monacale et dans une vision décharnée des faits officiels et de quelques grands hommes à l’usage du baccalauréat, ne comprennent guère que la race de leur pays existe, que la terre de leur pays est une réalité et que, plus existant, plus réel encore que la terre ou la race, l’esprit de chaque petite patrie est pour ses fils instrument de libération.
Avec un grand tort, Bouteiller a hésité à se passionner de préférence pour les formes de la pensée française. On saurait bien découvrir chez nous quelques éléments des bonnes choses qu’on loue dans le caractère des autres peuples et qui chez eux sont mêlés de poison pour notre tempérament. On met le désordre dans notre pays par des importations de vérités exotiques, quand il n’y a pour nous de vérités utiles que tirées de notre fonds. On va jusqu’à inciter des jeunes gens, par des voies détournées, à sourire de la frivolité française. Non point qu’on leur dise : « Souriez », mais on les accoutume à ne considérer le type français que dans ses expressions médiocres, dont ils se détournent.
Enfin Bouteiller, quand il passait en revue et classifiait les systèmes, ne se plaçait pas au point de vue français, mais chaque fois au milieu du système qu’il commentait. Aussi fit-il de ses élèves des citoyens de l’humanité, des affranchis, des initiés de la raison pure. C’est un état dont quelques hommes par siècle sont dignes. Gœthe fut cela, mais auparavant il s’était très solidement installé Allemand. Quel point d’appui dans leur race Bouteiller leur a-t-il donné ?
En vérité, l’affirmation puérile que la France est une « glorieuse vaincue » ne suffira pas à maintenir un sentiment national auquel on enlève ses assises terriennes et géniales.
Cet excitateur qui prétendait pour le plus grand bien de l’État effacer les caractères individuels, quitte Nancy ayant créé des individus dont il fait seul le centre et le lien. Ces lycéens frémissants dans sa main, on peut les comparer à ces ballons captifs de couleurs éclatantes et variées, que le marchand par un fil léger retient, mais qui aspirent à s’envoler, à s’élever, à se disperser sans but.
Dans la récréation qui suivit cette dernière classe, Sturel, Suret-Lefort, qui copie les attitudes de Bouteiller, Racadot, Mouchefrin, Saint-Phlin, le fûté Renaudin, Rœmerspacher le sage, délaissèrent leurs compagnons habituels, formèrent un groupe très animé et que leurs condisciples se montraient avec envie ou admiration. Plus spécialement doués pour le bien et pour le mal social, sans que nous puissions préciser si cette valeur procède du sang ou de la condition, ces enfants passent de la tête leurs contemporains et deviendront des capitaines, tandis que le surplus, marqué par le régime du lycée, se confondra dans la vaste vie qui sait faire des galets avec les quartz les plus durs… Ces sept jeunes gens notables, c’est-à-dire chez qui les impressions peuvent prendre une forme individuelle et les idées développer toutes leurs conséquences, ayant été distinguées et préférées ensemble, se sentent par là réunis. Chaque jour désormais, jusqu’à la fin de l’année, sitôt les rangs rompus, ils se retrouveront. Entre eux est une association.
De tels groupements sont fréquents. Les sorcières annonciatrices de Macbeth dansent, pour les jeunes gens imaginatifs, sur les préaux de tous les lycées. C’est au collège Bourbon que Taine fit la connaissance de Prévost-Paradol, avec qui il développa sa vie morale ; de Planat, le futur Marcelin de la Vie parisienne, qui lui donna des lueurs sur le monde des artistes et sur la vie élégante ; de Cornélis de Witt, passionné de la langue et de la littérature anglaise, et qui l’introduisit chez M. Guizot. C’est à l’École normale qu’il forma société avec About, Sarcey, Libert, Suckau, Albert, Merlet, Ordinaire.
Balzac a inventé treize hommes qui, vers 1828, auraient juré de se soutenir dans toute occasion et dont la puissance occulte aurait bravé avec succès l’ordre social. Cette imagination de romancier n’est pas absurde. La société tout entière doit appartenir à des gens distingués qui, à leur esprit naturel, à leurs lumières acquises, à leur fortune joignent un fanatisme assez chaud pour fondre en un seul jet ces différentes forces. Balzac, pour nous passionner plus sûrement, suppose qu’une de ces ententes fut volontaire. Le plus souvent elles naissent sans paroles échangées, d’un intérêt commun. On vit les amis de Victor Hugo, vers 1830, se lier par un pacte de ce genre sur son génie ; les partisans du prince-président, par un pacte sur son nom retentissant ; les familiers de Gambetta, par un pacte sur un grand sentiment populaire.
Que rêvent-ils, ces Lorrains-ci, jeunes gens de toute classe, grossiers et délicats mêlés ? M. Bouteiller est venu, l’ami de Gambetta, démocrate délégué par ceux qui se proposent d’organiser la démocratie, de fortifier et de créer le lien social. Il leur a prêché l’amour de l’humanité ; puis de la collectivité nationale. « L’individu, disait-il, vaut dans la mesure où il se sacrifie à la communauté… » Tel était son accent que leurs yeux se remplissaient de larmes ; mais c’est de voir un tel héros qu’ils s’émouvaient. Conséquence imprévue, trop certaine pourtant : il voulait asservir ces volontés, ces intelligences à l’État ; son contact fut plus fort et plus déterminant que ses paroles. Bouteiller a déposé en ces jeunes recrues des impressions qui contredisent sa doctrine en même temps qu’elles obligent leur intelligence et leur volonté. « Comme il est beau ! pensaient-ils, et qu’il fait bon aimer un maître !… Si nous pouvions l’égaler !… À Paris et tout jeune ! Par son mérite il est digne de commander à la France. »
Son image seule, sa domination de César les a groupés et spontanément les forme à sa ressemblance, ces jeunes Césarions. Déliés du sol, de toute société, de leurs familles, d’où sentiraient-ils la convenance d’agir pour l’intérêt général ? ils ne valent que pour être des grands hommes, comme le maître dont l’admiration est leur seul sentiment social.
Après que, sous le titre de devoirs, on leur a révélé les ambitions, aucun de ces jeunes gens ne veut plus demeurer sur sa terre natale, et c’est presque avec un égal dédain qu’ils accueillent ses invitations à choisir un milieu corporatif. Quoi d’assez beau, d’assez neuf pour leur imagination ? Leur métier ne sera qu’un gagne-pain subi maussadement. Ils veulent être des individus.
… Rien de plus fort que le vent du matin qui s’engouffre au manteau du nomade, quand, sa tente pliée, il fuit dans le désert. Quitter les lieux où l’on a vécu, aimé, souffert ! Recommencer une vie nouvelle ! Parfois, c’est délivrance… Mais ceux-ci, au seuil de la vie, déjà leur amour est pour tous les inconnus : pour le pays qu’ils ignorent, pour la société qui leur est fermée, pour le métier étranger aux leurs. Ces trop jeunes destructeurs de soi-même aspirent à se délivrer de leur vraie nature, à se déraciner.
À la fin de ce mois de mai 1880, M, Paul Bouteiller partit pour Paris, n’ayant été, bien que nous paraissions lui en faire porter la responsabilité, qu’un instrument de transmission. Des forces allaient marcher par le monde, auxquelles il avait donné l’impulsion, sans parvenir à les aiguiller.
Dans le même moment, les Fanfournot quittaient exaspérés Nancy, s’acheminant, eux aussi, vers la capitale pour frapper vainement aux portes des grandes maisons de l’Empire.
Произведения
Критика